[Cap au seuil|Sommaire rapide] Avant propos | espace | la vie | monde | les écologies | cénologie | sciences naturelles | interlude | protection de la nature | arbres | anthropocène | catastrophe | herbier/coquillier | ouverture : régions naturelles
Avant-propos > Terraqué le monde (1)
Texte mis en ligne le 16 mars 2019 et mis à jour pour la dernière fois 22 mars 2024 (61 révisions).
Je me représente la vaste enceinte des sciences comme un grand terrain parsemé de places obscures et de places éclairées. Nos travaux doivent avoir pour but, ou d’étendre les limites des places éclairées, ou de multiplier sur le terrain les centres de lumières. L’un appartient au génie qui crée ; l’autre à la sagacité qui perfectionne.
Diderot, Pensées sur l’interprétation de la nature, XV
Soit, je serais un mauvais écologue.
Notre époque a placé très haut les exigences écologiques, intimés aussi bien aux institutions qu’aux particuliers, et il devient difficile aujourd’hui de ne pas trouver dans les médias, les publicités, les discours des uns et des autres, de référence aux grandes « catégories » qui se rapportent, d’une manière ou d’une autre à l’écologie : développement durable, tri sélectif, énergies renouvelables, érosion de la biodiversité, agriculture biologique, réchauffement climatique et j’en oublie sans doute, tous ces thèmes, chapeautés par la méta concept de transition écologique, tous ces sujets n’intéressent l’écologie, telle que je la conçois, que de manière au mieux marginale.
Avec la politique oui : ces thèmes sont des thèmes politiques ; avec l’économie, oui : la politique est en partie une économique, et ces thèmes évidemment sont économiques ; avec une géopolitique, même ; et avec une éthique, sans doute, la politique est, pour une autre partie, éthique, ces thèmes sont donc éthiques.
Mais l’écologie ? L’écologie comme objectif ? L’écologie comme valeur ? Non. Cela n’a pas de sens. C’est comme promouvoir la mathématique ou la phonologie comme valeur et comme objectif.
L’écologie est avant tout une science. Une science complexe, oui, si l’on veut (mais existe-t-il des sciences non complexes, qui n’appellent pas d’autres sciences à son secours) ? Cette science possède sa méthode et son jargon, mais également son histoire et son épistémè ; elle ne parlent pas de la manière dont on doit se conduire moralement face à la nature ; il n’est même pas dit qu’elle traite uniquement de nature, ou en tout cas de nature comme entendue comme un idéal qui serait séparé, pour ne pas dire hostile à l’homme, en somme comme un éden d’où nous autres, êtres humains, aurions été chassés.
Évidemment en livrant ces mots à l’orée de ces pages, je livre en même temps d’emblée des réflexions, des opinions, disons-le, au moins pour l’instant, se présentent en contraste, pour le moins, avec l’ère du temps.
Mais il est vrai, tout bien considéré, que ces questions me sont finalement assez étrangères. Car je ne suis pas écologue. Un mauvais écologue : je suis naturaliste.
Je suis naturaliste : je pratique les arts de la science écologique (ou une partie d’entre eux au moins), et donc une partie de ses principes, méthodes, jargon et outils. Je le fais par passion, j’y reviendrai, et aussi à des fins précises notamment d’aide à la décision publique, en particulier sur les espèces à statut ou espaces protégés. Tout, dans cette dernière phrase, est inquiétant m’inquiète, et il s’agirait de s’arrêter sur chaque mot.. Je serais un mauvais écologue parce que je mesure la distance entre cette phrase et ce que je fais réellement, pourrait-on dire. Je n’aime pas ce que je fais. Or j’adore ce que je fais. Donc je ne sais plus quoi penser.
Comme je ne sais plus quoi penser, j’ai écrit. J’ai écrit de petites réflexions personnelles, souvent subjectives, parfois contradictoires, rarement sourcées ou méthodiques, qui décrivent quelques-unes ces questions que je me pose, devant les problèmes que j’affronte, constate ou déduis de ma pratique naturaliste. Ce sont ces pages.
Sources
Ces pages, d’abord, trouvent leur origine dans deux sources : d’abord, sur l’invite de Guénaël Boutouillet et la revue Remue.net, dans une série de textes elle-même intitulée Bornes[1]Bornes : https://remue.net/benoit-vincent-bornes, sur l’approche plutôt littéraire de mon expérience de naturaliste (j’exposerai ce parcours paradoxal plus loin) ; ensuite, par le biais d’une résidence d’écriture que j’ai réalisée avec la Maison transjurassienne de la Poésie et Marion Ciréfice à Saint-Claude, et grâce à laquelle j’ai rencontré le géographe Alexandre Chollier, avec qui j’ai profitablement échangé.
Dans cette première série de travaux je n’osais pas encore mettre en question l’écologie même, comme idéologie (je lâche le mot). C’est l’objet de ces nouveaux textes, et je devrais m’en expliquer ci-après.
En tout état de cause, ces textes parfois épidermiques sont le fruit d’une friction, d’une tectonique, entre ce qu’on doit faire et ce qu’on fait, entre l’éthique et la politique, en somme, et relèvent plus d’une espèce de cri du cœur que d’une théorie généralisée. Mais en tout état de cause, même si parfois leur teneur prête à la violence, à l’excès ou à la polémique, il faut garder en tête que ceci n’est jamais le but originel : le but originel de ces textes n’est pas de blesser ou d’humilier mais de souligner des problèmes, de poser des questions. Ce sont des textes critiques, le plus souvent fruits d’interrogations intimes, d’intuitions, et généralement élaborés grâce aux échanges ou à la lecture.
Ces essais ne sont pas des démonstrations scientifiques ou un travail universitaire. Les sous-tend fortement une appréhension sensible, subjective, des faits et des données qui y sont développés ; ce n’est pas une méthode (un chemin), mais plutôt son journal.
Au fond ces textes souhaitent œuvrer à restaurer le statut ambivalent de l’honnête homme, en dialogue avec (pour ne pas dire en travers entre) les humanités et les sciences ; ce lien est rompu depuis belle lurette ; tout concourt à démontrer qu’il est urgent de le choyer, de le réparer.
J’ai également écrit et réécrit de nombreuses pages lors d’une résidence au château de Fontainebleau en 2021, après les confinements dus à la pandémie de Sars-Cov-2. Cette résidence a permis de consacrer du temps à plusieurs des textes ici présents (notamment d’éplucher une très abondante bibliographie sur l’histoire et la théorie écologiques), mais elle a surtout été l’occasion pour moi d’organiser et d’animer des rencontres sur le thème qui en quelque sorte leur est transversal : le lien entre l’humain et la nature, à travers deux dialogues entre un artiste et un scientifique. Ces rencontres eurent lieu dans la galerie des Cerfs du château le 15 janvier 2022, avec d’une part Hélène Frédérick et Francis Hallé, et Antoine Volodine et Luc Garraud d’autre part. Je voudrais ici les remercier infiniment d’avoir bien voulu participer à cette expérience originale, et j’en profite pour remercier également David Millerou pour avoir cru en cette idée et l’avoir rendue possible. De l’écologie considérée comme une science humaine[2]Mercis Et, parlant d’humains, je dois ici faire amende honorable, jusqu’au bout, et remercier ceux grâce auxquels ce texte peut exister : mes maîtres en botanique, René Roux, mon … Continue reading.
Enfin j’ai profité de ma présence à l’Imec à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe sur plusieurs semaines de 2024, à l’invitation de Yann Dissez, pour travailler sur des thèmes similaires (la nature, l’homme et l’archive) m’ont permis de « renforcer » ce travail notamment au contact des œuvres (et leurs archives) de plusieurs auteurs appartenant au fonds des archives. Plus précisément, j’ai exploré dans ces inventaires autour du territoire de l’archive une question vers laquelle, finalement, toutes ces pages tendent : l’habiter un espace. J’inscrirais ainsi l’ensemble sous cette « épitaphe » :
Point d’archive sans un lieu de consignation, sans une technique de répétition et sans une certaine extériorité. Nulle archive sans dehors[3]Jacques Derrida, Mal d’archive. Une impression freudienne, Galilée, 1995..
Écologie, disais-je
Car il s’agit bien d’écologie, tout compte fait. Mais aussi de sciences humaines.
Ces pages traitent de petites et de grandes questions. Parfois résumés en détail, que le lecteur pourra juger anodines ou inutiles, secondaires, ou même parfois trop abstruses ou absconses, voire cuistres. Peu m’importe : c’est parce que je suis passé par ces petites questions, ces petits scandales, que ceux-ci m’ont aidé à élaborer une ‘réponse’ (plutôt qu’une ‘leçon’), et d’abord une réponse à moi-même.
Mais l’écologie est-elle le seul objet en lice ? Il s’agit de dire que puisqu’il y a -logie, il y a donc déjà un double : un discours sur l’éco--, l’oikos, la maison, un discours sur la maison, qui se pose devant (dessus ? en travers de ?) la maison elle-même : il y a redoublement, comme dans tout logos, entre le dehors et ce qui est dit de lui.
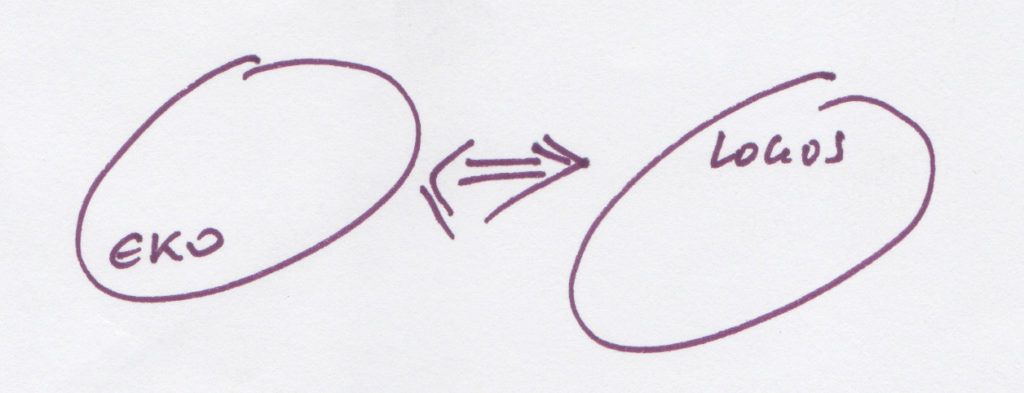
On a tous en tête ces panneaux de divulgation scientifique, devant un monument, un paysage, n’importe quoi, qui dissimule le sujet en question, le paysage, le monument… (C’est même le propre du langage, et je pense avoir démontré n’être pas dupe de la question :« je dis une fleur ! », etc[4]La littérature inquiète, Publie.net, 2020..). Poussé « à la limite », cette idée induit que l’écologie s’est séparée, peu à peu, de son fondement théorique, et l’écologie est devenu une mode, voire un parti politique, alors qu’elle est avant tout une science, avec sa méthode, son histoire, son épistémè, son jargon, etc.
C’est que lorsque nous parlons d’écologie, lorsque nous en parlons de manière sérieuse, théorique ou critique, nous nous heurtons inlassablement à des contraintes relevant de l’axiologie. C’est que l’écologie nous apparaît comme en décrochage par rapport aux autres domaines de la pensée (sauf peut-être la géographie – mais n’est-ce pas le cas de toutes les sciences humaines ?), et ce pour plusieurs raisons :
- l’écologie travaille à la fois du côté de la science numérique et de la science textuelle, entre science formelle (dure) et science humaine (molle), entre mathesis et philosophia, entre science et pensée, peu importe le couple choisi, elle est de toute manière ‘des deux côtés’ ;
- l’écologie, jamais très éloignée de la biologie (et pourtant non confondue avec elle), n’est jamais non plus très éloignée de l’anthropologie (idem) ; de fait, elle touche, de par sa composante biologique, à la nature même de l’homme, ce qui n’est jamais une position aisée du point de vue du théoricien ;
- l’écologie, de par son aspect tautologique, nécessairement dérivé de son emprise ontologique,
soit le vivant ; le vivant est ; je suis vivant donc je suis, etc. nous déporte gentiment sur les rivages de l’être (l’ontologie, donc) et, par conséquent, à tous les risques qui y sont liés, et qui confinent à l’anthropomorphisme, comme les délirants mouvements de droit de l’environnement (non pas au sens de la protection de la nature, mais au sens de considérer la nature comme une personne morale, et donc défendable), ou les non moins discours catastrophistes de l’anthropocène et de la collapsologie.
Le plus grand de ces risques, pour moi, étant l’affinité très nette en ce début du XXIe siècle entre écologie et spiritualité, voire adhésion déguisée à une religion (en atteste la fortune de l’encyclique du pape François Laudato si’ dans les réseaux et les cénacles de la « pensée écologique »). Ce dernier point, qui ne me semblait pas aussi fort, à l’époque de la rédaction des premières pages de ces chroniques, me saute aujourd’hui aux yeux (entre adulation du GIEC, violence politique des communes nouvellement passées chez les Verts, et permanente atmosphère de reproches et oukases « pour une planète plus verte »…).
Enfin on tâchera de toujours garder en tête qu’il sera question ici en priorité de l’écologie au sens théorique du terme, et non des mouvements politiques qui se réclament de l’écologie ou se déclarent écologistes. Il y a certes des points communs et des ponts tout à fait possibles entre écologie et politique (en tant simplement que l’écologie peut intéresser la société), mais il me paraît incongru voire contre-productif de considérer une science comme manifeste politique (là encore cela nous évoque les grands moments de la morale…) et, pis encore, comme crédo. En revanche, la récupération des termes, de la méthode ou de la théorie écologiques à des fins politiques pourra être abordée, mais toujours au regard de son origine scientifique, non du point de vue strictement politique.

Et comme elle s’est ainsi chargée de morale, elle a largement laissé les autres fronts à découvert : aujourd’hui d’autres domaines viennent grignoter ce qui faisait jadis le terrain des ‘sciences naturelles’, et d’autres scientifiques ou d’autres compétences scientifiques sont désormais requises : mathématiques, génétique, informatique, etc. N’étant pas disposé à investir le champ moral, je ne me reconnais pas non plus dans le discours numérique et technique de bien de mes collègues d’aujourd’hui (qu’on pourrait qualifier de « technocentrés ») – et sans doute ce qui apporte de l’eau au moulin de l’idée que je suis devenu un mauvais écologue.
Bilan de compétence
Peut-être est-il utile, non à titre hagiographique mais factuel, de présenter en premier lieu rapidement mon parcours de naturaliste ; si cela n’a rien d’exemplaire, cela pourra éclairer l’amertume qui me saisit à l’heure actuelle, amertume qui a contribué à l’écriture de ces pages, en souhaitant qu’elle ne se transforme pas en aigreur ni en désespoir.
J’ai effectué des études de lettres, et j’ai entamé un doctorat en littérature comparée. Comme je devais travailler, avec un enfant nouveau-né, je me suis vite rendu à l’évidence : je ne pourrais vivre sereinement en étant chercheur, sans compter que je n’avais aucune vocation à l’enseignement.
Je me suis donc simplement dit qu’il fallait que je trouve un métier que j’aimerais exercer et qui me libère du temps pour l’occupation dont je rêvais, l’écriture. On ne décide pas d’écrire impunément. Je me suis consacré à l’écriture en dépit (par exemple) de la musique, qui m’attirait aussi (mais pour laquelle je n’avais pas les talents requis, ou du moins la « niaque » requise pour développer de potentiels talents).
En faisant une espèce de bilan de compétence personnel, je me suis dit que je devrais essayer de trouver un métier qui corresponde à mes premières amours, à savoir le monde de la rivière (un habitat !) ; petit j’adorais passer des heures dans la rivière, à observer les petits animaux qui la peuplent : larves d’insectes, petits crustacés, vers en tout genre ; j’avais songé un temps suivre des études dans ce sens, mais n’étant guère attiré par les sciences (la physique, les mathématiques), j’avais abandonné l’idée… L’occasion se présentait à nouveau. Après quelques recherches, je m’inscrivis en BTS Gestion et protection de la nature (GPN) en option Gestion des espaces naturels ; un BTS célèbre pour tous ceux qui souhaitent travailler dans la nature.
Je souhaitais travailler sur les habitats, les milieux naturels, bref, l’écologie. Durant le BTS je découvris la botanique (avant j’étais incapable de nommer un arbre, les plantes les plus communes…) et surtout la phytosociologie (même si de manière extrêmement superficielle – et, je dois le dire, dans une perspective erronée). Le diplôme en poche, je déposai l’idée de travailler dans le milieu de la rivière (comme technicien de rivière par exemple), et dus reconnaître que la gestion d’espace naturel n’était pas généralement envisageable.
Pourquoi ? D’une part certains de ces métiers nécessitaient non seulement une mise à niveau (d’études, mais encore bien souvent un concours administratif, deux choses pour lesquelles je n’étais plus disposé à consacrer du temps ou de l’énergie) ; d’autre part, par le BTS, j’ai vite réalisé que le métier, aussi noble soit-il, est, de par le fait, très attaché à un seul espace, tout en étant fortement attaché à un territoire et à ses collectivités, autres horizons qui ne m’attiraient guère.
Avec un ami, Emmanuel Héroult (qui lui était alors technicien de rivière), nous créâmes une association dont le cœur d’activité aurait été l’éducation à l’environnement. Avec son aide, l’activité pouvait ainsi être un moyen d’approcher la nature et, le cas échéant, comme association de protection de la nature, la structure se donnait les moyens de réaliser des inventaires et des plans de gestion naturalistes, ou de développer des outils de communication, voire des publications. Ce projet m’occupa dix ans durant.
Totalement dévoué à la cause associative, mâtinée idéologiquement d’éducation populaire, je m’investissais sur de nombreux fronts : terroir, patrimoine, insertion… ; je contribuais à relancer le Réseau drômois des associations d’éducation à l’environnement, travaillais avec le réseau régional (le GRAINE Rhône-Alpes), m’y investissant de plus en plus. Je cofondais avec quelques collègues la Société Botanique de la Drôme.
Avec le GRAINE, je participai à la mise en œuvre des quatrièmes rencontres nationales de l’EEDD, qui devaient se tenir à Lyon en 2014, en partenariat avec le réseau École & Nature.
La préparation et la tenue de ces assises me mobilisa sur les années 2012 et 2013. Lorsque nous arrivâmes au Ministère de l’Écologie (ou le nom qu’il portait alors) le 09 avril 2013, je considérai que j’avais fait le tour de la question, et pris la décision d’arrêter l’éducation populaire. Je connus que j’étais las. Las de porter à bout de bras un « projet associatif » dont chaque « action » devait trouver financement (entre-temps, ça s’était raidi, côté subventionneurs, on ne finançait plus facilement du fonctionnement, mais essentiellement de l’action) et le montage du budget devenait un vrai casse-tête pour des miettes, et il fallait par exemple faire cinq dossiers qui mobilisaient plusieurs journées administratives pour obtenir 5 000 euros : le projet « Passages » de notre association, à cheval sur le Vaucluse et la Drôme, et donc les deux régions, PACA et Rhône-Alpes, mais aussi deux « pays » (« Cinquième Pôle », « Une Autre provence », toponymes qui font rêver) et un « LEADER[5]Acronyme pour « Liaison entre actions de développement de l’économie rurale » », nous a tués : la région Rhône-Alpes mettait six mois à instruire un dossier, puis six mois pour payer ; malgré nos aides à l’emploi, on se retrouvait très vite en difficulté, et ce tous les six mois, et ce n’est certes pas la banque coopérative (qui d’évidence ne comprenait pas le fonctionnement d’une association, ce qu’était un projet associatif, ce qu’était un budget associatif et sa dépendance mortelle à la trésorerie !) qui nous aiderait. Las, je constatais que le temps administratif me coûtait un tiers de mon agenda ; moi pendant ce temps, je ne parvenais pas à me salarier régulièrement ; l’atmosphère n’était pas, quoi qu’on veuille nous faire croire, à l’« économie sociale et solidaire » ; ceci nourrissait une réflexion qui est toujours d’actualité : si les associations deviennent des entreprises, financées par le public (en réalité de plus en plus financées par les actions non gratuites qu’elles peuvent mener), où est le sens de l’associatif ? Se professionnaliser c’est bien, mais est-ce alors le rôle d’une association, l’association est-elle la structure idoine pour cela ? Je ne le croyais plus. Je rêvais des associations de randonneurs, ou même de sportifs, qui n’ont aucun compte à rendre à LEADER !
Sur le parvis du ministère, devant l’invasive vergerette du Canada, m’ayant été donnée ma part du buffet froid, une bouchée de nourriture locale et biologique contenue dans un petit verre à pied de plastique ancestral, je connus que j’en avais fini de la question écologique politique.
Je créai alors une microentreprise et m’installai à mon compte comme naturaliste. Ce n’était pas par esprit de start-up nation ou appât du gain, c’était pour arrêter le collectif, ou plutôt la folie des dossiers et des réunions. Et si la formule n’était pas satisfaisante, l’autoentreprise étant bien sûr le pire exemple de la néolibéralisation du travail (une espèce de pré-Uber), et qui allait me projeter violemment vers le monde de l’appel d’offre (après celui de la subvention pleurée à genoux, le monde de la caution arrachée avec les dents), au moins me permettait-elle d’étudier la nature… Étudier ses formes, comprendre les relations, embrasser les communautés… Entre-temps, je me formai, beaucoup, avec Philippe Julve, deux années, en phytosociologie, en cartographie, en malacologie, en botanique encore et toujours avec mes deux maîtres botanistes René Roux et Luc Garraud.
C’est après plusieurs années de pratique, au contact avec d’autres réseaux, d’autres acteurs, et dans le contexte global de verdissage en cours que j’ai écrit ces lignes. Ce ne sont pas des réflexions purement théoriques, elles ont souvent une base pratique : un problème à résoudre, un argument à défendre ; un outil à fabriquer ; une opinion à déconstruire…
Le droit à l’erreur
Le lecteur pourra à juste titre se demander où placer cet ouvrage, s’il relève du pamphlet ou de l’essai, du traité d’écologie ou du traité politique, du côté des sciences molles ou du côté des sciences dures ?
En le parcourant, on verra ainsi souvent (ceci, je l’écris après coup, à la fin de la relecture de mes propres paroles) souligné le balancement entre deux pôles. Qu’il s’agisse de l’objet de mon propos ou du sujet qui écrit (moi-même), on pourra dire par exemple qu’il balance :
- entre nominalisme et essentialisme ;
- entre inductivisme et déductivisme ;
- entre réductionnisme et holisme ;
- entre spécialisme et généralisme ;
- entre amateurisme et professionnalisme ;
- entre subjectivisme et objectivisme ;
- etc.
Toutes ces grandes divisions – binaires, du reste – qui nourrissent abondamment les débats philosophiques, scientifiques, épistémologiques, depuis la nuit des temps, l’écologie bien évidemment ne s’en exempte pas. On dirait même, après une certaine fréquentation des textes fondateurs, qu’elle s’y complaît. Une raison est peut-être celle que nous évoquons, avec Emmanuel Catteau, dans le chapitre 6, à savoir le caractère médian des sciences naturelles, non seulement entre sciences formelles et sciences humaines, mais encore l’évidente partialité du chercheur à leur égard (des vivants parlent du vivant).
Ainsi donc, il est à la fois simple et complexe (tiens) de répondre à la question : d’où parles-tu ici ? Oui, je suis généraliste, et oui, je suis également écrivain ; on notera que l’objectivité n’est pas nécessairement au rendez-vous : j’espère que le lecteur comprendra que là n’est précisément pas le problème. C’est précisément parce que l’objectivité n’est pas au rendez-vous que l’on peut essayer de formuler une réflexion critique. Laquelle porte sur une l’expérience vécue d’une pratique réglée, à laquelle se greffe une série de questionnements conceptuels et méthodologiques : il n’y a là rien qui ne relève strictement de l’affabulation ou de la superstition[6]Même si on ne dédaigne ni la fiction ni l’espoir..
C’est aussi que cette opération de détermination/dénomination a ici un aspect performatif (ce qui n’est finalement pas si souvent le cas) : la préservation ou au contraire le chamboulement, sinon la destruction (dans le cadre des aménagements).
Je voudrais faire passer l’idée qu’il est plus important de comprendre la structure des cénoses, leur fonctionnement, leur dynamique, que les espèces prises individuellement. C’est d’ailleurs l’un des problèmes de fond du naturalisme. Je critique la protection de la nature ou l’écologie contemporaine pour certaines de ses préoccupations spécifiques, qui peuvent dégénérer en réflexes cynégétiques ; elles dénotent pour moi un certain anthropomorphisme (on connaîtra que telle est la question centrale de ces pages) : on privilégie ce qui ressemble à l’être humain : les mammifères, puis les tétrapodes, puis les animaux… ou bien les espèces selon le « service » qu’elles rendent (ou la nuisance qu’elles procurent) : plaisirs esthétiques (les orchidées, les lépidoptères), santé et alimentation, peste ou parasite, valeur marchande… En soi, ce n’est pas un problème : il faut bien connaître les espèces qu’on mange ou qui soignent pour pouvoir les manger ou se soigner avec. Mais ce sont des usages qui ne relèvent pas du naturalisme, qui devrait être, justement, impartial, et considérer toutes les espèces, toutes les cénoses et tous les habitats sur le même plan. Le poids aussi bien législatif que financier mis sur certaines espèces démontre le contraire. On peut arguer qu’il faut bien commencer quelque part, et j’en conviens ; gageons que les plathelminthes ou les friches industrielles seront considérées à leur juste valeur dans le futur.
Je lisais justement dans le deuxième tome de la Classification phylogénétique du vivant de Lecointre et Guyader[7]Guillaume Lecointre, Hervé Le Guyader & Dominique Visset, Classification phylogénétique du vivant, Belin, 2006. J’en profite pour signaler une très belle recension de cet ouvrage par… … Continue reading que les téléostéens (les ‘poissons osseux’) représentent la moitié des vertébrés et que, malheureusement, on constate que la proportion de pages qui leur sont généralement consacrées dans les manuels ou les guides ou encore dans la recherche, n’atteint pas ce nombre, au profit des autres tétrapodes, dont nous faisons nous aussi partie. Les exemples sont nombreux : les orchidées écrasent bien des plantes ; tous les oiseaux, reptiles et amphibiens sont protégés, alors qu’ils ne représentent pas même 0,5 % de la faune totale. À l’inverse 0,5 % des insectes sont protégés, qui représentent plus de la moitié de la faune. Aucun champignon, aucun ver, aucune algue, aucun invertébré autre qu’arthropode ou mollusque ne sont protégés[8]Je reproduis en annexe quelques chiffres qui n’ont prétention ni à l’exhaustivité, ni à l’extrême actualité..
Mais là encore, je dois l’avouer, le doute me saisit. Je suis généraliste certes, et je suis donc naturaliste : une grande partie de mon travail consiste à réaliser des inventaires de certaines espèces (les plantes vasculaires, les mollusques continentaux) sur un territoire donné (la France métropolitaine) à un moment donné (quelques printemps-été de quelques années du monde) et dans un cadre bien particulier : une recherche partiale de la rareté et de la fragilité opérée par des structures privées pour le compte de l’État ou de ses divers échelons, avec pour objectif la connaissance/sensibilisation, la préservation/conservation, la gestion/restauration. Le plus souvent, et de plus en plus avec le temps, ces recherches répondent à l’application de directives d’un objet institutionnel transgressif, post-politique, étrangement démocratique, l’Union européenne.
Je travaille donc pour le service public, tout en contribuant à sa destruction ; je travaille pour la protection de la nature, tout en contribuant à son évaluation financière[9]En cela tout à fait en écho aux propos de Bernard Charbonneau dans Feu vert [1980], que L’Echapée a eu la bonne idée de republier en ce tout début 2022. ; je travaille enfin pour la nature, entendue non comme univers mais comme environnement, avec l’arrogance et la prétendue maîtrise de l’un de ses membres (l’espèce humaine). Ergo, je doute.
À ce malaise personnel et intérieur s’ajoute une véritable interrogation technique : mon travail, faire des inventaires, consiste donc à donner des noms à des entités naturelles, des espèces ou des groupes écologiques d’espèces, les cénoses. Ensuite seulement vient le temps de l’interprétation, de la cartographie, puis de la formulation de préconisations d’objectifs et d’actions.
Je passe sur le fait que beaucoup de naturalistes, comme dans bien des professions, sont soumis à de nombreuses contraintes techniques liées à l’administration, à des questions financières, matérielles, temporelles, qui existent ici comme ailleurs, et qui relèvent plus généralement du travail, et de son droit. Je ne m’éterniserai donc pas sur le fait, par exemple, que nombre de naturalistes relèvent du droit privé, que la recherche devrait rentrer sinon dans le cadre du service public, du moins dans celui, indépendant et universel, de la science, soit de plus en plus envahie de partenaires financiers – comme chacun sait d’ailleurs. On s’étonne que la pratique libérale de l’appel d’offre, avec toutes ses dérives bien connues (le moins-disant étant favorisé au profit du mieux-disant), soit généralisée dans le cadre naturaliste, aussi bien au niveau de l’inventaire de terrain que de la recherche scientifique universitaire. Mais ce n’est pas de ces malaises-là que je parle.
Je parle de la difficulté personnelle, intime, de devoir donner des noms. La réponse consiste donc à améliorer le regard, et c’est une réponse professionnelle : être naturaliste, c’est apprendre à observer, à reconnaître, à nommer. Mais notre objet d’étude est un être vivant, une réalité organique, dont tout le génie tient précisément dans la souplesse des formes, la dynamique intégrée, et l’hybridation (entre vie et mort, entre phénome et génome, entre individu et espèce) inhérente, ce qui en fait un objet labile, vagile, et pour le dire simplement contradictoire par nature. Par conséquent, être naturaliste, c’est apprendre à douter, à accepter le doute comme outil mais aussi comme méthode, et parfois même comme réponse.
Il y a par exemple un élément incompressible, si j’ose dire, et qui relève de ce que notre objet est une réalité extérieure, qui nous pousse dehors.
L’un des plaisirs de ce métier, est que l’inventaire est inféodé à la saisonnalité : la grande majorité des plantes viennent au printemps, et en début d’été, bien des espèces ne sont déjà plus « lisibles » ; c’est peut-être un peu moins le cas avec les animaux, c’est vrai, mais en tout état de cause, on observe une période de dormance, l’hiver, qui nous éloigne de notre objet. Ainsi, à chaque printemps, il faut s’y remettre et, en quelque sorte, réapprendre : réapprendre les véroniques, les violettes, les céraistes… Certains d’entre nous n’ont pas ces problèmes : une fois qu’ils ont appris une plante, ses caractères distinctifs, ils ne l’oublient plus jamais. Cela relève de la conformation des individus et pour autant que je puisse en juger, ce n’est pas mon cas. Chaque année je me replonge dans les flores et les faunes avec autant de curiosité que d’inquiétude.
Mais plus généralement, le fait est que l’on doit noter les noms des espèces dans un carnet, et cette opération me jette parfois dans l’angoisse. Et si je me trompais ? Plus encore, c’est la peur de ne pas être au niveau qui m’étreint : c’est-à-dire de ne pas être au niveau des autres. Le problème se pose évidemment peu pour des espèces communes et bien connues, comme le chêne vert ou le petit-gris ; il se pose modérément pour toutes les espèces difficiles à déterminer (pour tout un tas de raisons). Il se pose en vérité pour toutes les autres espèces, qui représentent la majorité ou, si on veut tourner l’explication du problème autrement, elle se pose au moment du choix, c’est-à-dire lorsqu’il faut aller vite et avancer, c’est-à-dire sur le terrain. Il est vrai que je me considère plutôt comme un naturaliste que comme un botaniste ou un malacologue – et encore moins écologue. Je revendique le fait d’être un généraliste et, d’ailleurs, les débats très pointus sur les groupes difficiles (et ils sont nombreux : les pissenlits, les ronces chez les plantes ; les hydrobies, les clausilies chez les escargots), ne me passionnent guère.
C’est que j’ai été d’abord formé par les sciences du langage et de la littérature et, ce faisant, je ne peux pas être dupe de la puissance qu’est le langage, et tous les possibles qu’il autorise, en particulier la fiction. Je ne serai pas écrivain si je ne doutais pas. Mais suis-je encore un naturaliste si je me donne à la fiction ?
Je suis donc un mauvais écologue parce que je voudrais être un bon naturaliste.
Or le naturaliste, pour résume, se heurte à tout l’inquiétude qui je viens de décrire à grands traits, et qui repose finalement sur une dimension tout à fait singulière, celle de la situation de l’inventaire, qui se déroule en certaines circonstances ou occasions. C’est cela, je crois, qui fait le sel de ce travail, ou l’objet de cette recherche. Objet et sujet se rencontrent en un hic et nunc en perpétuelle mutation : il y a va donc de l’occasion comme du hasard, du possible comme de l’échec. Et croire être infaillible est une erreur.
À quoi j’ajouterais enfin que le métier de naturaliste n’existe pas ou plus en tant que tel, mais qu’en plus il est n’est plus possible d’exercer ces compétences dans un cadre professionnel satisfaisant. Nombre d’entre nous nous passionnons pour une espèce, ou un groupe d’espèces, notamment sur notre temps libre, mais nos compétences, requises dans nos travaux, ne sont pas valorisées en tant que telles : nous autres, naturalistes, nous ne faisons plus de naturalisme. Le naturalisme demande du temps, demande d’observer, demande de décrire, et requiert donc une part d’imaginaire qu’on cherche de plus en plus à résorber voire à détruire. Nous voyons actuellement des applications informatiques qui sont en mesure de reconnaître et nommer des espèces par une simple photographie : ces outils sont simplement l’aboutissement de la logique de la manière dont les politiques de conservation de la nature envisagent aujourd’hui notre métier. Bientôt de simples appareils seront en mesure de décrire un espace, et de le représenter. Une fois que les pieds et les mains ne seront plus utiles, les drones suffiront – coûteront beaucoup moins chers et ne se plaindront pas de leur dos ou genoux[10]Je me rappellerai toujours ce responsable d’une DREAL, la DRIEE pour ne pas la nommer, me demander à quoi servait cet inventaire d’escargots millimétriques, que personne ne connaît et … Continue reading.
Ceci pour souligner le fait que notre activité se retrouve donc aujourd’hui engluée dans de nombreuses problématiques qui dépassent et de loin la corpus théorique propre des « sciences de la nature ». Mais ces sciences de la nature ne peuvent pour autant s’abstraire de la part de généralisme qui les fonde[11]Souvent on s’entend dire, devant os conditions de travail dégradées : « ah oui, mais c’est un ‘métier passion' ».. Et le doute qui les étreint. Et la circonstance qui chaperonne l’ensemble.
Un état de nature ?
Mon propos se place en contraste, si l’on veut, dans cette réflexion métaphysique d’Hans Jonas : le « oui dit à l’être » impliquerait que pour prendre en charge nos actions nous nous placions dans la position de ce/celui que nos actions impliquent, ou, dit autrement, que, pour prendre en charge nos actions, nous nous placions dans la position de celui qui ne peut agir. Cette aporie est pourtant fondamentale : nous nous plaçons dans la position de la bactérie, de l’oiseau ou de l’habitat, alors que nous ne sommes pas des êtres coloniaires, que nous ne savons pas voler, et que nous nous ne sommes pas fondamentalement une cénose. Soit. Mais demande-t-on à un juge d’être un criminel ? Demande-t-on à un docteur d’être malade ? Nous partageons deux choses avec la bactérie, l’oiseau ou l’habitat, et peu s’en faut pour moi que c’est deux choses ne fassent qu’une : le terrain (la planète) et la vie. C’est à mon sens suffisant, et pour autant pas nécessaire.
J’ai toujours préféré qu’on témoignât, si j’ose dire, après avoir été égorgé[12]Albert Camus, « Avant-propos » de La Maison du peuple de Louis Guilloux, Grasset, 1927..
La difficulté (et c’est très sensible avec Hans Jonas), est de pouvoir se défaire, dans cette étreinte, de toute destinée moralisante, si j’ose dire – c’est ce qui est d’ailleurs toujours difficile avec la morale, et plus encore dans le monde hors-sol (pour le meilleur comme pour le pire) que nous connaissons.
Bref, ce qui m’intrigue ici, je vais le formuler d’autre manière : le naturaliste travaille (ou devrait travailler) sur la nature de l’être plutôt que sur la naturalité (ou être nature). Je m’explique : la naturalité, souvent évoquée dans les inventaires ou les plans de gestion, renvoie à un état ‘maximal’ ou ‘vénérable’ ou ‘souhaitable’ d’un ensemble vivant (taxon ou syntaxon). On opposerait une naturalité, disons, génuine, au monde artificialisé et anthropique : la ville, la friche, l’agrosystème, etc. La naturalité est valorisée par rapport à l’artificialisé. Il y a un jugement qualitatif, un jugement de valeur. Eh bien je prétends qu’un bon lecteur de milieux, un bon naturaliste, devrait plutôt regarder l’ensemble vivant en soi, en se débarrassant des notions de valeur et de qualité (et a fortiori de quantité), et observer simplement la nature de l’être, quand même cet être est constitué de charbon, de béton ou de plastique. C’est très difficile à envisager, mais cela nous débarrasse déjà d’un premier (et principal, pour ce qui nous concerne ici) problème : la charge à la fois morale et émotionnelle d’un état édénique de nature, i.e. d’un dieu qui s’appellerait Nature.
Cette position est d’autant plus difficile à adopter aujourd’hui qu’elle implique, chez Jonas, à la fois une charge morale et à la fois un net retour à l’être, balayé généralement par la philosophie moderne. La difficulté étant donc de parvenir à muer la morale en éthique, et d’autre part à « désessentialiser » l’être, lui ôter sa majuscule, sans toutefois l’abandonner totalement à la simple nature de phénomène.
Mais l’autre corollaire tout aussi étonnant, toujours depuis Jonas, c’est la place et le rôle de l’être humain dans cette opération. Ainsi, à rebours de ce qui est communément admis, la nature devrait travailler conjointement avec l’humain, pour ce que l’humain est, plus encore que le démiurge qu’il croit être, celui dont la capacité démiurgique (détruire, créer) charge d’une responsabilité indiscutable (ce qui n’est pas loin non plus de la pensée de Levinas).
On peut aisément se fourvoyer et considérer que dans ces conditions, cette responsabilité de l’humain traduit une nouvelle séparation nocive entre lui et la nature. Je crois au contraire que cet espèce de lucidité sur notre capacité intrinsèque réaffirme à bon droit notre participation intègre et pleine à ce qu’on appelle nature généralement, c’est-à-dire à la totalité du réel. Si on ne veut pas établir de hiérarchie entre l’humain et la nature, considérer l’humain comme une partie de la nature (au même titre que les autres parties de la nature), avec ses singularités (notamment le langage, l’agriculure, la cité, l’art, le sacré), offre une piste de pensée saine et audacieuse, avec de surcroît l’avantage de nous défaire de dieu.
On médite sur cette gageure (c’est bien pourquoi j’écris ces lignes), à savoir que dans l’expression « nature de l’être » on entend résonner très fort le mot « être »…
Être ou ne pas être un bon naturaliste ?
Il y a des hommes pour qui une pensée est d’autant plus vraie qu’elle est plus rassurante (qu’elle les rassure davantage sur eux-mêmes) ; il y a au contraire des hommes, qui, ayant appris d’expérience que la vérité n’était pas toujours selon leur désir, finissent par n’adopter, d’un mouvement inverse, que les systèmes les plus propres à ruiner tout ce pouvait encore les consoler de leur sort. Il n’est pas impossible que les uns et les autres soient guidés et soutenus par un sincère amour de la vérité. [13]Charles Ferdinand Ramuz, Remarques [1929], L’Âge d’Homme, p. 118..
Structure de l’ouvrage
Quelques mots encore pour présenter l’organisation de l’ouvrage…
Celui-ci est composé de textes différents par la forme et pourtant rassemblés dans ce qui se voudrait à la fois une espèce de guide, de memento, pour moi et ceux qui auraient envie de me lire, et comme une espèce de divagation libre sur les thèmes liés à l’écologie ; et à la fois, ce livre propose des mises à jour conceptuelles, ou tout du moins des interrogations sur l’usage ou la définition de certains concepts, il fonctionne aussi donc comme un vade-mecum ; enfin il n’hésite pas à dénoncer certains travers actuels de l’écologie (on aura compris mes réserves envers l’écocentrisme, l’anthropocène et la collapsologie, mais il y en a d’autres) ; il fonctionne alors aussi comme un repoussoir.
J’ai écrit ailleurs[14]La littérature inquiète, op cit. que le monde, le réel, pouvait s’appréhender par des dosages, précis mais variables, de trois capteurs différents mais interdépendants : les sens (qui conduisent à l’émotion ou l’art), les connaissances (qui aboutissent à la réflexion ou la philosophie), et l’expérience (qui forment le gros du problème : celui du sujet, de son individu, de son avatar, et de sa biographie et généalogie).
Ainsi trouvera-t-on dans cet ouvrage deux parties : la première (EKO) qui présente plutôt des réflexions conceptuelles sur l’écologie en tant que science, et dans son rapport aux autres domaines du savoir, dans son histoire et son épistémè, et en proposant, de loin en loin, quelques ajustements conceptuels ; la seconde (LOGOS) qui sont pratiquement des diatribes, des disputes sur différents sujets propre à l’écologie d’aujourd’hui, et qui suscitent autant d’incompréhension que de désaccord.
Entre ces deux parties, je glisse un texte singulier, un mélange entre quelques réflexions propres au naturaliste, et une autre pièce coécrite avec Luc Garraud, botaniste au CBNA et auteur de la Flore de la Drôme, et qui est une espèce de création scénique dont le sujet est « à quoi sert le naturaliste ? ». Ce dernier est né sur l’invitation de la Maison des Écrivains et de la Littérature à l’occasion d’une rencontre sur littérature et montagne (et réchauffement climatique), à Chamonix, en 2018. J’en profite pour indiquer que le texte sur les sciences naturelles a été coécrit avec Emmanuel Catteau, phytosociologue du CBN de Bailleul. On trouvera enfin, comme une espèce de postface, un texte la « région naturelle » ou « pays », entendue comme unité territoriale heuristique et surtout manifeste pour le retour de l’homme dans l’écologie. Ce texte a nourri et s’est nourri d’une conférence réalisée avec le photographe Eric Tabuchi à l’École de la nature et du paysage de Blois en 2018.
Ainsi ces réflexions, notées en marge d’une pratique professionnelle, et nourries du sel critique, n’ont pas l’ambition d’un rapport documenté et daté, d’argumentaire imprenable, de démonstration… plutôt des divagations, dans le secret désir d’aérer les esprits chagrins, car aujourd’hui l’écologie est triste comme Greta Thumberg, et ce dans l’espoir qu’elle vienne enrichir la lutte qui vaille, à savoir la lutte contre le néolibéralisme, plutôt que de l’épauler comme un avatar baizuo 白左.
Cap au seuil, retour au bercail, rentre tes moutons. Reprenons depuis le début.
[Cap au seuil|Sommaire rapide] Avant propos | espace | la vie | monde | les écologies | cénologie | sciences naturelles | interlude | protection de la nature | arbres | anthropocène | catastrophe | herbier/coquillier | ouverture : régions naturelles
Avant-propos > Terraqué le monde (1)
References
| ↑1 | Bornes : https://remue.net/benoit-vincent-bornes |
|---|---|
| ↑2 |
MercisEt, parlant d’humains, je dois ici faire amende honorable, jusqu’au bout, et remercier ceux grâce auxquels ce texte peut exister : mes maîtres en botanique, René Roux, mon voisin, naturaliste aguerri, qui m’a emporté avec lui sur les sentes du Tricastin en quête de plantes rares, Luc Garraud, auteur de la Flore de la Drôme, un projet éditorial fou vidant à synthétiser les connaissances sur un département qu’il aime au point d’y habiter, et qui a transmis au natif dudit département que ej suis et qui n’y habite plus, le goût de l’exactitude du mot. Tous deux sont également auteurs de textes littéraires de haut vol, et la proximité fut rendue facile par leur goût de la langue et de la fiction. De grands botanistes m’ont accompagné sans que je saisisse toujours l’origine de ces amitiés : Jean-Pierre Reduron, spécialiste mondial des Apiacées (carottes et cousines), Jean-Louis Amiet, naturaliste de Nyons qui travaillait « dans son coin » à une encyclopédie qui mettra du temps, hélas, à pénétrer l’insitution, Marcel Barbero qui adouba une cartographie que j’osai faire de son pays, les Maures, et qui représentait pour moi, le meilleur de la pensée écologique botanique méditerranéenne. Dominique Mansion, spécialiste des trognes et impérissable croqueur des plantes de la Flore forestière française. Robert Portal, guitariste et spécialiste des poacées (graminées). Bernard Didier, spécialiste des marais de Haute-Marne et musicien lui aussi. Et puis mes collègues phytosociologues, sans qui je n’aurais jamais rien compris à la phytosociologie : Philippe Julve, qui lutte inlassablement pour l’avancée du savoir, Emmannuel Catteau, qui sans cesse remet sur le plan de travail nos plates certitudes et produit des guides de survie phytosociologiques inégalés, Frédéric Bouffard, dont l’aménité n’a d’égal que le savoir et la capacité de formation sur la forêt et ses multiples dimensions, des mycorhizes aux lutins. Et les collègues italiens de la SISV, Emilia Poli Marchese, Daniela Gigane, Silvia Assini, Roberto Venanzoni, Bruno Foogi, Romeo di Pietro. Enfin mes collègues malacologues ou zoologues, dont Cédric Audibert, éminent expert malacoloqgue mais surtout entomologue du musée des Confluences, Manganelli de l’Université de Sienne qui avec Bodon de Gênes ont décrit de nombreuses espèces nouvelles pour la faune. Et tous les passionnés, nombreux, Jean-Jacques Blanchon, Henri Michaud, François Pinet, Rapahël Zumbiehl, Caroline Farvacques, Emilien Henry, Gilles Tessèdre, et mes collègues Matteo Barcella, Thierry Reynier, Olivier Lannès, Eric Sardet, Rémi Duguet. J’ai eu la chance de connaître ces grands noms, avec qui j’ai pu échanger avis et questionnements, et c’est d’eux que je tire mes réflexions, pour originales qu’elles puissent être. |
| ↑3 | Jacques Derrida, Mal d’archive. Une impression freudienne, Galilée, 1995. |
| ↑4 | La littérature inquiète, Publie.net, 2020. |
| ↑5 | Acronyme pour « Liaison entre actions de développement de l’économie rurale » |
| ↑6 | Même si on ne dédaigne ni la fiction ni l’espoir. |
| ↑7 | Guillaume Lecointre, Hervé Le Guyader & Dominique Visset, Classification phylogénétique du vivant, Belin, 2006. J’en profite pour signaler une très belle recension de cet ouvrage par… Claude Levi-Strauss, dans Critique. |
| ↑8 | Je reproduis en annexe quelques chiffres qui n’ont prétention ni à l’exhaustivité, ni à l’extrême actualité. |
| ↑9 | En cela tout à fait en écho aux propos de Bernard Charbonneau dans Feu vert [1980], que L’Echapée a eu la bonne idée de republier en ce tout début 2022. |
| ↑10 | Je me rappellerai toujours ce responsable d’une DREAL, la DRIEE pour ne pas la nommer, me demander à quoi servait cet inventaire d’escargots millimétriques, que personne ne connaît et que d’ailleurs personne ne voit, et pourquoi cela coûtait aussi cher. C’était avant l’ère macronienne. |
| ↑11 | Souvent on s’entend dire, devant os conditions de travail dégradées : « ah oui, mais c’est un ‘métier passion' ». |
| ↑12 | Albert Camus, « Avant-propos » de La Maison du peuple de Louis Guilloux, Grasset, 1927. |
| ↑13 | Charles Ferdinand Ramuz, Remarques [1929], L’Âge d’Homme, p. 118. |
| ↑14 | La littérature inquiète, op cit. |
