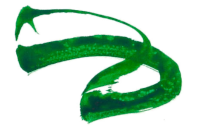J’ai bientôt découvert que ce livre n’en était pas un. Pas un vrai. Ce n’était pas un vrai livre. C’était un assemblage. Une composition, un patchwork. Cette découverte est le fruit d’un hasard absolument inespéré ; un hasard sec, que je partageais bientôt avec Emmanuel Delaplanche, qui avait longuement travaillé sur le processus de réappropriation chez Louis-René des Forêts.
Qui, aujourd’hui, viendrait mettre en question l’œuvre imposante, élégante et exigeante de Louis-René des Forêts ? Il est pourtant aujourd’hui établi qu’une majeure partie de ses livres est un collage, une réécriture, une digestion — par ailleurs ivre de puissance littéraire, je ne remets pas du tout en cause l’œuvre de des Forêts, que je tiens pour l’un de nos plus grands écrivains — de textes américains divers et variés, une phrase de-ci de-là, parfois moins, parfois des paragraphes entiers. Emmanuel avait ainsi soutenu une thèse sur ce thème ; et en plus du texte théorique de la thèse proprement dite, il avait composé également un fort volume constitué de deux colonnes ; sur la première, le texte de des Forêts, sur l’autre, en regard, les textes des influences (Faulkner, Dos Passos, Hemingway, Caldwell, Miller, Bataille, Leiris, Kafka…).
Emmanuel était donc la personne idoine à qui faire part de ma découverte — je croyais alors dur comme fer, je dois l’avouer, que le réel était le fruit d’agencements de notre perception, agencements très perméables à la fiction (ce qui n’est pas très original, j’en conviens volontiers), l’esprit étant toujours prompt à jeter son propriétaire dans la plus doucereuse des confusions.
Mais Emmanuel fut injoignable à ce moment. Nous habitions à l’opposé du pays, lui et moi, et je ne parvenais pas à le joindre, ni au téléphone, ni via les moyens électroniques.
Je revenais à mon texte. Je revenais à la coïncidence. Peut-être Pierre Senges, Christian Garcin auraient pu m’aider, ou bien un spécialiste de l’œuvre de Borges. Mais je ne connaissais plus personne à l’université — et ceux que j’avais connus jadis (la plupart déjà vieillards chenus ou marcescents) avaient dû passer l’arme à gauche. Et je n’étais pas assez familier avec les deux auteurs pour les importuner pour ce qui devait être des broutilles.
J’eus alors l’idée d’appeler Bernard Hoepffner, dont je savais l’intérêt pour ces surprises textuelles, et je savais son amour pour Borges ; je le connaissais depuis longtemps, puisque nous avions habité durant des années dans le même village de la Drôme. Avec cette nuance que durant des années, chacun de nous ignorait totalement les activités de l’autre, bien que nous connaissions des personnes en commun, et que nous nous dévouions, dans nos maisons respectives, à la littérature, etc.
L’écriture est presque un secret infamant, ou une pudeur, ou une maladie, qu’on n’exhibe pas facilement en société. Ou une jalousie. C’est déjà le cas dans les grandes villes, mais dans un village rural, où les préoccupations vont vers les affouages, les sangliers ou les fédérations sportives, c’est encore plus net.
J’allais trouver Bernard afin de lui présenter mon questionnement. J’avais en effet trouvé, dans l’Histoire de l’infamie de Borges, qui est l’un des livres les plus musclés et très habilement composés qui soit, des éléments qui me semblaient parvenir d’ailleurs. Il faut que je sois prudent, car je ne voudrais pas déclencher de vives polémiques, inutiles sur ces sujets. Il faut que je sois patient, également, et que je prenne le temps de bien dérouler le fil de ma découverte.
Patient je le fus, car Bernard était en déplacement pour un long temps, et j’eus le loisir ainsi de laisser enfler ce qui devenait un délire et, à la faveur de l’été finissant, dont les contours se dissolurent paradoxalement, au point que les arguments devinrent moins nets et la force de la découverte une bête pointe émoussée.
C’est donc à l’automne que je parvins à rencontre Bernard, n’étant plus très assuré moi-même de la pertinence de ce que j’avançais. Nous n’avions pas eu besoin de beaucoup marcher pour trouver les pieds de mouton et les giroles que nous partagerions pour fêter les retrouvailles.
Nul n’ignore que Borges accordait une éminente importance à l’intertextualité, c’est-à-dire aux échanges plus ou moins conscients entre un texte et un autre texte (citations, échos, reprises de thèmes ou de personnages, etc.). Il avait écrit ces phrases définitives, à ce propos, dans ses Inquisitions (« Kafka et ses précurseurs ») :
Le fait est que chaque écrivain crée ses précurseurs. Son apport modifie notre perception du passé aussi bien que du futur. (édition Pléïade, t.I, 753)
Tout a commencé lorsque je pris ce même volume pour chercher cette même citation. Les marque-pages du volume n’indiquaient rien de particulier, mais mon livre était considérablement annoté, et les passages que j’avais si longtemps cités étaient indiqués par de petits onglets de ma fabrication (papier + scotch), à la manière de post-it archaïques. C’est pourquoi je fus surpris de trouver trois pages cornées, cornées ensemble je veux dire, et dont le coin rabattu indiquait dans le texte les mots « ordre secret ».
Je n’ai plus aucun souvenir d’avoir moi-même corné ces pages, surtout par trois (c’est ce qui me frappa le plus), mais il arrive que les livres se cornent d’eux-mêmes, dans les déménagements, les transports peu précautionneux dans les sacs, etc. Je relève cette phrase ainsi indiquée.
En outre, le genre dont je parle est complexe. Le désordre, l’incohérence, la variété ne sont pas difficiles à réaliser, mais il faut qu’ils soient régis par un ordre secret qui deviennent graduellement apparent. (« Sur The purple land », Autres inquisitions, t.I, 775)
Je feuilletais ensuite le volume, relevant de-ci de-là quelques phrases qui pouvaient être utiles à mes recherches. Et je tombais sur ce texte que, jusque ici à ma connaissance, je n’avais pas vu, ou alors que j’avais complètement enfoui sous des dizaines d’autres — cette masse de lecture s’intitulant aussi l’oubli. C’est ce passage que je montrai à Bernard.
Je me levai pour prendre un peu d’eau. En repassant dans mon bureau, je vis le corps sans vie d’un scorpion que le menuisier venu prendre des mesures pour une fenêtre à écrasé d’un coup sec de brodequin. Il est resté tel quel, depuis, je n’ai pas eu le cœur de le déplacer. Il est là, dans un coin de la pièce, on n’a pas l’impression qu’il est mort. C’est comme s’il me regardait.
On ne connait jamais l’histoire avant de l’écrire. Avant qu’aient disparu les circonstances qui ont fait que l’auteur l’a écrite. Avant qu’elle ait subi dans le livre la mutilation de son passé. Car ce que nous appelons commencement est souvent la fin. La fin, c’est l’endroit d’où nous partons. En effet, on ne finit jamais de lire. Les livres s’achèvent, eux, nous le savons, comme nous savons de manière certaine que la mort existe. Or on ne fait jamais que vivre jusqu’à ce point fatal.
De la même manière, un même individu n’aime pas obligatoirement le même livre à dix-huit et à quarante-huit ans. Nous portons un drôle de regard sur notre passé. Un regard extérieur. On a la tête lourde, on est pris de vertige, comme si le regard ne se portait pas en arrière pour s’enfoncer dans les couloirs du temps mais s’éloignait, ou nous éloignait de ces livres lus, emportés loin, séparés de leur auteur ou de leur lecteur, celui qu’on était alors. Des fragments de cet être, fragments anesthésiés ou embaumés par la mémoire demeurent pourtant, mais de livre, d’histoire, et de celui qu’on était alors, plus de trace. Notre biographie est l’assemblage de ces oublis, de ces vacances.
Qui je fus est un inconnu que j’aime en rêve. Mon souvenir n’est rien, et celui que je suis et ceux que je fus s’agitent dans deux rêves différents. Ce que nous sommes devenus, ce que nous sommes, nous croyons que c’est le fruit d’un cheminement, au pire d’une contingence. Mais en vérité, nous oscillons sans cesse entre la fuite et la nostalgie ; et leur objet, l’objet de la fuite, l’objet de la nostalgie, n’est-il pas la mort même ?
Pour une raison ou une autre — et je ne saurai pas aller beaucoup plus loin que cette incertitude — ce passage me semblait étrange. Quelque chose ne collait pas. J’avais l’impression non seulement d’un écho lointain — mais quel livre peut-il prétendre ne pas s’assourcer en d’autres livres ? — mais également un sentiment de faux, de factice, de modelage abusif.
Je ne savais pas comment dénouer mon doute. Je cherchais des mots qui permettent d’activer cet écho et je me dis que le syntagme « à dix-huit et à quarante-huit ans » était assez originale (pourquoi quarante-huit) que peut-être un fil pouvait en être tiré.
C’est ainsi que je découvris, caché dans ce fragment, une citation d’Ezra Pound1.
Fier de ma découverte, je l’indiquais prestement à Bernard, juste après qu’il eut fini de le lire. Il sourit. Son front se plissa pourtant en une matière soucieuse.
Je considère Bernard comme un homme pragmatique, beaucoup plus pragmatique que je ne le serais jamais. Il est pragmatique à la manière de ceux qui travaillent dehors (son visage le rappelait et son passé en témoignait). Il a ce recul sur les choses, cet écart avec les évènements, de ceux à qui on n’en conte pas. Il a cette malice et ce sens de la contingence de ceux qui habitent sur un île. Grand — plus grand que je ne le serais jamais — il laisse le temps que les choses viennent à lui. Il continuait à me fixer intensément, gravement, comme si j’avais dit une énorme grossièreté, ou plus exactement comme si j’avais omis de le faire.
Il se leva, tourna dans la cuisine qui surplombait la prairie. Nous étions dans sa maison à l’écart, non loin d’une colline désolée que bordait un petit ruisseau. On l’entendait sans prêter l’oreille, on n’entendait que lui, à vrai dire, c’est comme si l’essence de notre dialogue se fut cristallisée en son corps, à ses déplacements à lui.
Enfin Bernard est traducteur, c’est-à-dire qu’il a l’habitude de déjouer les entourloupes que croient semer dans leur texte les auteurs. Le ruisseau se laissait entendre, nous priant de le suivre, requérant toute notre attention (ou la mienne seulement ?).
Un long moment s’écoula, mais un moment de ruisseau, c’est-à-dire un moment inqualifiable, en réalité. Soudain il s’exclama, d’une voix étrange, aussi claire ou éclatante qu’elle était calme et de bas volume. Une voix douce et grave.
— C’est Ezra Pound.
Je fus non seulement flatté de cette attestation qui se colorait d’une vérité hélas devenue évidente, mais également soulagé — je n’aime pas déranger impunément les gens.
— C’est Ezra Pound. C’est bien lui.
(Un nouveau ruisseau passa dans la pièce.)
— Mais combien d’auteurs s’inspirent d’autres auteurs (et je sentis que ma joie était futile, égoïste ; j’en fus profondément touché) ? Il n’y a pas de quoi en faire un plat, quoi.
Je me sentis ridicule. Je me perdis en confusion et transpirai. Il se rassit, et se releva.
Nous avons passé le reste de l’après-midi à deviser paisiblement sur l’intertexte en racontant des anecdotes plus ou moins attestées. Que plusieurs passages de Proust viennent d’Anatole France. Que Baudelaire n’a peut-être pas écrit tous ses poèmes en prose. Que les journaux fournissaient d’excellents textes tout prêts à recopier. On évoqua encore Borges, et Shakespeare, et Homère, et Houellebecq, et le plagiat, et le droit d’auteur.
Sans parler de la traduction qui est un plagiat toujours renouvelé, sans cesse original. « La traduction est comme ce plat de champignons », l’un de nous avait dit ça en désignant la poêle à demi vidée.
Lorsque nous nous quittâmes, déjà sur le pas de la porte — la nuit était venue et déjà la forêt dégageait son parfum d’humidité — j’avais froid, il dit : « Attends » et rentra dans la maison. Il allait chercher je ne sais quoi. Et il revint avec un livre. Le livre de Borges, en édition originale.
— Tiens, j’en ai deux, tu peux le garder, puisque ça t’intéresse.
La voiture rentrait seule, j’étais perdu dans mes pensées, un peu en colère contre moi-même, un peu hagard. Le vin que nous bûmes ajoutait à ma confusion. Arrivé chez moi, je me couchai de suite, avec le livre argentin. Je cherchai le passage incriminé.
Je le cherchai et le cherchai encore.
Je le cherchais en vain2.
- 1 « Il n’y a aucune raison pour que le même individu aime le même livre à dix-huit et à quarante-huit ans », ABC de la lecture.
- J’ai reçu ce jour un message d’Emmanuel, qui écrit : « L’emprunt à l’air évident. Historia universal de la infamia date de 1935. ABC of Reading date de 1934. Donc ça colle. Et comme pour Des Forêts, c’est à un de ses illustres contemporains que Borges est attentif. Mais Borges a-t-il lu en anglais ? En espagnol ? Son emprunt ressemble-t-il plus à l’original ou à la traduction ? Difficile à savoir, il faudrait retrouver la date de la traduction de Pound en espagnol… et vérifier dans le texte. »
Et plus loin :
« Il n’y a pas de quoi en faire un plat, quoi. » Pas de quoi en faire un pla-giat, c’est sûr. Mais bon, c’est intéressant tout de même de savoir que pour son livre et à ce moment-là de son livre, Borges a pensé (a ouvert ? a rendu hommage ? a eu besoin ? a salué ?) Ezra Pound, l’américain. »