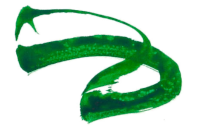Microfiction (cérofiction) de la série Résidences et écrite à l’occasion de la résidence Situer organisée avec Ciclic en région Centre-Val de Loire
Avant, en piquant de la queue, tu ressemblais à une abeille,
tandis que maintenant tu piques de la langue et ressembles au serpent.
Lettre de Roscelin de Compiègne à Abélard
« C’est un décor de cinéma », il pensait.
Après un premier moment d’égarement. Mais comment s’égarer ? il n’y a pas d’issue possible : il n’y a que la route, droite sur des kilomètres, et pas moyen de se tromper, pas moyen de s’en détourner, de se dépister. C’est la plaine, à l’infini la plaine, la plaine à l’infini, à l’infini de l’infini, parce que derrière la plaine, derrière l’horizon, qu’on voyait depuis l’habitacle, lorsqu’on croyait y être parvenu, il y avait un autre horizon, tout aussi lointain.
Parfois toutefois, de grands virages contournaient les parcelles, et c’était étrange aussi, ces angles droits insoupçonnés, invisibles dans les hautes herbes ; ce n’en était pas moins un tunnel sans à-côté.
Il roulait vers la ville et déjà, si loin, il commençait à percevoir les plus hautes tours. Il n’avait jamais vraiment traversé la Beauce, ou autrement que rapidement, par les voies ferrées ou les autoroutes ; c’était la première fois qu’il allait y résider quelques jours. La première fois, qu’ « à hauteur d’homme », pour ainsi dire, il allait passer et vivre en son dedans.
L’égarement, c’était aussi la difficulté pour le regard de s’accrocher à quelque chose… une espèce d’oppression, du ciel peut-être qui était très haut mais qui était très épais aussi. Les seuls repères étaient les églises, les châteaux d’eau, les pylônes, les éoliennes, et surtout les silos, leur patrimoine restitué d’immenses cathédrales mécaniques, rongées par la rouille ou le lichen, fières absides dédiées au travail agricole.
Un peu d’anxiété, un peu de panique (écrasement dû au vide, ou fuite impossible), puis, avec le temps, l’habitude (il semble que l’on s’habitue vite en réalité, quelques dizaines de minutes suffisent ; c’est pareil dans d’autres lieux majestueux, là où l’humain est ridicule : les Alpes, la Bretagne, les déserts et les steppes des Causses…), c’est plutôt une grande sensation de sérénité, celle justement qui vient à l’homme effacé dans le paysage. La majesté (ce mot insistait), la majesté du paysage.
Après un temps, tout ce temps ramassé en quelques instants, il pensa donc : « c’est un décor de cinéma ».
*
Je ne saurai dire si le paysage avait changé. Comment changer l’uniforme ? Pourtant nous nous étions bien là, pour témoins, et nous vieillissions. Est-ce parce que nous, nous changions, que changeait le paysage autour de nous ? Oui sans doute.
Je me rappelle les moutons, mais ils ne sont plus là sous mes yeux.
Je me rappelle les chevaux, mais ils ne sont plus là sous mes yeux.
Je vois pourtant les blés, et eux toujours pèsent dans le champ, ondulent sous le vent perpétuel. Je me rappelle le gros vent, et je le vois. Je me rappelle les cieux, et je les vois.
Je ne sais pas pour les silos, peut-être ont-ils grandi, et je ne sais pas pour les châteaux d’eau, peut-être ont-ils poussé à leur tour eux aussi ? Je me rappelle aussi d’avant les pylônes, les éoliennes.
Alors oui en effet, insensiblement… comme un léger dévers amène imperceptiblement un relief, et un relief un paysage, et un paysage une mélancolie, c’est-à-dire une mémoire déchue.
*
C’est exactement ça, poursuivit-il dans sa tête : un grand film de la route, à l’américaine, et pourquoi pas ? Nous sommes imprégnés des vastes paysages de la plaine américaine, aussi bien dans les films que dans les séries et même les romans. Ils éveillent en nous de mystérieux imaginaires, d’héroïques personnages, des luttes sauvages. Mais lorsqu’on évoque la Beauce dans notre pays, surgissent en premier lieu des traits négatifs. « Parce que les gens de la ruralité sont méprisés », pensa-t-il.
D’ailleurs quand il avait cherché des éléments touristiques sur la Beauce, c’est l’Amérique qui est venue. La Beauce du Canada. Il ne comprenait pas les visites que proposaient le site, il ne connaissait pas de mont Sainte-Marguerite, et il ne voyait pas de monts en Beauce.
Il était venu faire des recherches sur la forêt des Carnutes (passons sur le cadre et les détails professionnels), dans l’espoir de trouver sur le territoire des fragments de forêt ancienne, historique même, dont l’étude du sous-sol apporterait de nouveaux (et qui sait ? précieux) éléments sur les mouvements climatiques. L’analyse bibliographique avait stipulé que le sol et le sous-sol n’avaient jamais permis l’installation d’une forêt en tant que telle, et des études récentes semblaient indiquer que la forêt sacrée se situait dans une zone comprise entre Orléans et Chartres, entre la Loire et le Loir. Le mot Beauce lui-même viendrait d’un mot gaulois pour dire « espace découvert », ou « champagne »… Or la conformation des paysages depuis au bas mot la fin de la république romaine l’avait incité à fouiller les lieux, précisément parce qu’à l’évidence, et contre toute logique, les lieux n’avaient que peu changé.
À peine débuta-t-il de compulser les documents (qu’il avait réservés depuis chez lui), qu’il tomba sur une liasse de feuilles deux fois pliées en deux, glissées dans le rabat d’une jaquette. Elles attirèrent aussitôt son attention ; il hésita et se demanda s’il avait vraiment le droit de les ouvrir et de lire. Il balaya la petite pièce du regard ; la lumière était tamisée, il portait des gants, il agissait dans le cadre professionnel : il en conclut qu’il n’y avait pas de raison qui s’opposât à ce qu’il les considère comme une part de son corpus.
C’était une lettre, adressé à un certain Philémon Sevestre, écrite par un énigmatique MP, le 16 juin 1907 (il n’y a pas d’enveloppe). Il recopia ce passage dans son carnet.
« On prête beaucoup de qualités aux écrivains, sans doute trop. Mais ce qu’on ne peut leur reprocher, mais peut-être est-ce un vice qui s’est affermi sur le terreau de la défiance, ou, comme une seconde nature, s’est béquillé à une espèce de mauvaise foi que d’aucuns nomment sensibilité, ou pire, lucidité, ce qu’on ne peut leur reprocher, disais-je, c’est leur manque de tact au regard des réalités du monde. Mais un drôle de phénomène se produit, lorsque par exemple je vois agir mon personnage, le vois évoluer dans un monde qui peu à peu, d’étrange manière, s’affranchit de ma tutelle, et c’est comme si mon stylographe n’était plus ni férule, ni houlette, pas moins une laisse dont on se sert, vous savez, pour maintenir et contraindre les animaux domestiques, ni un mors, qui est utile à diriger les chevaux. C’est comme si moi-même me dédoublais, lui se séparant de moi, et moi devenant lui, lui écrivant et moi lisant, je ne vois pas comment le dire autrement, ni de manière plus claire.
Vous savez, cher ami, que, lorsque je vous retrouve ici, notre entretien vient nourrir ma propre pratique ; c’est peut-être aussi parce que votre société, précise, positive en quelque sorte, faisait écho à mon propre cheminement, tantôt hésitant, tantôt fougueux, et l’un et l’autre s’articulent comme certains objets, ces petits véhicules destinés au loisir des petits enfants.
En quoi tout roman est double ; non seulement le lecteur écrit le livre que l’auteur lui a lu une première fois, mais dans ce geste c’est aussi un paysage qui est chaque fois échafaudé et renouvelé, à la manière d’un décor de théâtre itinérant. »
*
L’après-midi, au musée de la mémoire agricole qu’il visita, c’est avec grande surprise qu’il retrouva sur l’une des affiches le nom de P. Sevestre, accompagné de ces mots : « L’histoire veille à maintenir l’essentiel de son propos sous le boisseau. Ce qui reste inaccessible au commun, ce n’est certes pas ce qui est claironné ou, moins vulgairement, ce qui est consigné et sigillé dans les livres solaires.
En quoi toute histoire est double ; on dira qu’il y a la grande et la petite histoire, mais je ne fais pas cette différence car, de toute façon, à chaque fois c’est aussi un paysage qui est échafaudé et renouvelé, à la manière d’un décor de théâtre ambulant.
On prête beaucoup d’intentions aux historiens ; c’est leur faire beaucoup d’honneur. », avec cette simple indication : La chronique et l’histoire au Moyen-Âge, 1909.
*
Très tôt le soleil était monté et avait arrosé tous les recoins du pays.
Depuis la Conie, qui s’écoulait sans hâte, nous devions nous rendre jusqu’à l’exploitation. L’été et le printemps, on y allait à pied, on se levait plus tôt, très tôt, en été à cinq heures. Quand les derniers bosquets que le ruisseau nourrissait disparaissaient, on entrait dans le monde de la céréale (il y a avait bien quelque champ de patates ou de trèfles, mais dans l’ensemble c’était de la céréale, et parmi elles dominait le blé). Nous sommes un pays du pain.
*
Il avait trouvé un gîte, chez Odette, une dame à la retraite, une ancienne commerçante, boulangère, et dont le mari, nonagénaire, ancien facteur ; ils louaient deux ou trois chambres d’une belle ferme située en plein cœur du pays. Nous discutions tous trois, tandis que mijotait le faitout de rata qu’elle s’était proposé de lui cuisiner, puisqu’il s’intéressait « aux choses désuètes ». Elle s’enquit de l’avancée de ses recherches. Elle lui apprit que Sevestre était un nom commun dans le secteur, qui lui était familier puisque des cousins à elle le portaient, des parents éloignés du côté de Fains-la-Folie, de gros exploitants depuis toujours. Il se fit à l’idée que le mot était une dérivation de sylvestre… et se demanda jusqu’à quel point la forêt avait hanté l’imaginaire local.
La discussion venait alors sur le travail agricole, ce qui avait changé, ce qui avait disparu. « Mais aujourd’hui, finit-elle, les gens vivent mieux, même les jeunes, ils sont moins souvent contraints par le temps, les aléas. Les machines ont pris une place considérable, oui, mais il faut toujours quelqu’un pour les mener, pour les entretenir… »
Après le dîner, il fit quelques pas dans le village et gagna ses « faubourgs », les belles maisons de pierre blanche. Dans le village, on se sentait à l’abri. Dès qu’on en sortait un peu, on était à nouveau renversé par l’immensité du vert. Comme le ciel était immaculé, un début de lune vint éclairer en douceur les armées et les armées d’épis.
C’était une étrange sensation, un peu comme naviguer en mer. Et les villages étaient comme des îlots. Il y avait cette pression tellurique des îles. Il ne doutait plus que la forêt d’ici avait été un mythe, des histoires qu’on raconte pour effrayer les petits enfants. Ou les subjuguer. Jules César le savait déjà, et je ne sais pas quelle était l’intention de Rabelais lorsqu’il fit dire à Gargantua « Je trouve beau, ce ». Mais il était en plein accord avec lui.