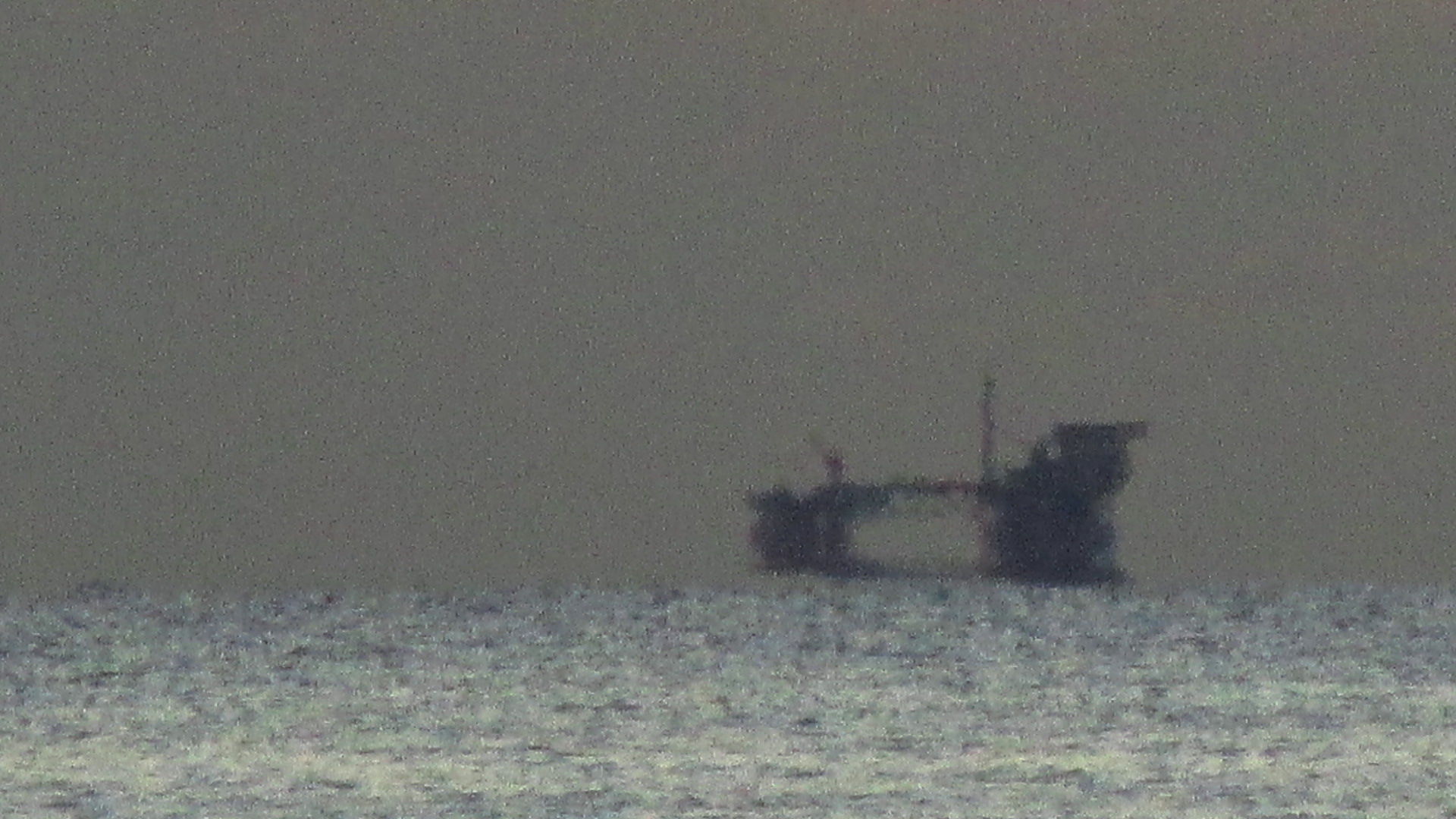
Je publie ici la version initiale d’un texte que m’avait demandé la revue Talweg des éditions Pétrole, qui associe plasticiens et écrivains autour d’un thème, en l’occurrence ici « Le sol ».
Il y a quelques temps, pour des raisons tout à fait circonstancielles1, j’ai franchi le Passo del Muraglione, dans l’Apennin tosco-romagnole, entre Florence et Forlì.
C’était une route toute neuve pour moi, je n’avais jamais mis les pieds (ou les roues) dans ce coin de l’Italie — il y a tellement d’apennins méconnus. Mais la destination, elle, m’était familière.
J’ai traversé là des paysages de collines qui ressemblaient fichtrement à l’arrière-pays de mon village natal, dans le sud de la Drôme, entre Comps et Vesc, Teyssières et Valouse. En me rendant dans ces endroits, malgré les raisons circonstancielles évoquées plus haut, je savais que je revenais aussi sur des terres appartenant à mon passé.
Je me suis alors posé la question du lien entre la terre et le passé. Ce lien entre terre et passé, on pourrait le décrire comme une appartenance.
Pour une raison qui nous échappe, qui à mon humble avis relève tout autant de notre biologie que de notre histoire (notre roman) et de notre culture, nous éprouvons toujours une distance entre notre moment présent et les lieux de notre passé. Ce qui se cache derrière cet étrange acoquinage du temps et de l’espace2, drôle de bête à deux dos, c’est sans doute notre propension à faire de notre environnement notre territoire et, en résumé, à mesurer l’écart subtil qui se glisse entre “propriation” et “appropriation”.
La pluie se mit à tomber. Peu après le col, je m’arrêtais dans un virage pour vérifier l’espèce d’une apiacée que je voyais depuis le début de l’ascension. Je stoppai la voiture sur un bas-côté peu amène, et constatai finalement la présence de l’Herbe-aux-cerfs ou Cervaire (Cervaria rivini Gaertn), une plante plutôt commune, mais ici aux feuilles d’une taille démesurée en comparaison des individus qui croissaient justement “par chez moi”.
La pluie se muait en orage, le tonnerre faisait trembler le paysage, vibrer les vitres, les membranes.
En me dirigeant vers la voiture, je me rendis compte que le sol était jonché de coquilles d’escargots, d’une espèce que, cette fois-ci, je ne connaissais pas. Je cherchai quelques exemplaires de coquilles vides, mais toutes les coquilles que je croisais étaient habitées, et même dans les recoins, sous les herbes, dans les déclivités du sol, au pied des arbustes ou sous les cailloux, je ne trouvai aucune coquille vide, même abîmée. Soit ces bêtes étaient venues en masse pour un grand rassemblement, soit les coquilles très fragiles disparaissaient rapidement sans se fossiliser3.
« Les fossiles », je pensai, ayant repris ma route.
Là où croît Cervaria rivini, “par chez moi”, justement, on trouve pas mal de fossiles. Les marnes, qu’affectionne l’apiacée, en sont en effet des réservoirs connus (en particulier les petites balles de fusil que sont les bélemnites).
Les fossiles ne sont-ils pas précisément ce « temps consolidé ? »

Et, ma pensée suivant son fil comme je descendais vers l’Emilie-Romagne, pressé par l’orage à mes trousses, je me disais que j’étais, comme la Cervaire, plutôt un produit des marnes, ces sols étranges qui ne cessent de s’ébouler, qui alternent entre l’état solide comme la pierre sous le soleil, et le brouet pégueux sous la pluie.
J’allais donc vers la Romagne4, le prétexte étant la visite d’un tracteur pour un ami, dans les collines surmontées de puys (de poëts, dit-on “par chez moi” ; ici, c’est poggi). La route étant longue, je me suis demandé si je n’allais pas en profiter pour retourner sur les traces de mon enfance, sur cette portion de côte défigurée de l’Adriatique, où ma famille et moi avions passé un long temps des vacances d’été de mon enfance.
Ces paysages étaient inscrits en moi sous la forme d’une petite marque, pas une cicatrice tout à fait, plutôt et plus exactement comme un cal ou un trauma, non pas chargé de douleur, mais plutôt d’excessive mélancolie. J’y suis allé la première fois à l’âge de six mois ; la dernière à dix-sept ans ; quinze jours chaque année. Je pourrais bien dire que, si l’on veut, j’y ai grandi. Et si j’étais attaché à ma terre natale5, je n’avais pas totalement réussi à me détacher de celle-ci. C’est-à-dire que pesait le sentiment d’une irrésolution qui s’était transformée avec le temps en lancinante inquiétude.
Je me destinais donc à revenir en ces lieux que je n’avais pas vus depuis plus de vingt ans, et j’allais donc directement à la rencontre de mon passé. Ce passé concrètement actualisé sous la forme d’une “ville”, de sa culture, de son territoire, de son agriculture, de son sol, etc.
À propos de Martin Heidegger (et de fantômes), Jacques Derrida6 entretient la confusion entre ces deux mots : propriation — ce qui fait le propre d’une chose, d’un individu ; et appropriation.
L’être, c’est-à-dire le « moment présent de ma conscience », se situe probablement entre les deux.
La ville aurait-elle changé ? Ou bien aurais-je perdu toute trace de souvenir ? Aurais-je perdu toute trace de moi-même ? Ne prendrais-je pas le risque de me perdre moi-même ?
Difficile de faire saisir au lecteur ce qu’à pu représenter cette portion de territoire pour moi, enfant. Il me semblait que ce dehors, ce lointain, était pour moi la condition même de mon être au monde. Précisément ceci : que mon être propre passait par la peur de la perte (et donc l’appropriation) de ce territoire extérieur à moi-même.
On mesure ici les impasses, les apories. Mais c’était pourtant cela. Cette terre, cette marne, ce sable, en un mot ce sol était à moi. C’était le mien.

Le sable des châteaux de sable ou des courses de boules à l’effigie de coureurs cyclistes, les pistes bordés de pneus multicolores des circuits minuscules des petites voitures foraines, les carreaux des devantures des magasins que chaque soir nous arpentions en famille, jusqu’au goudron fondu, aux effluves des égouts marins, aux maigres laisses de mer, aux butins de la pêche, aux odeurs de cuisine, aux arrière-cours et aux serres qui limitaient la rue balnéaire et ouvraient sur l’immense territoire agricole de la Romagne (et de l’Emilie).
Et puis la mer — cette mer singulière, dans laquelle on avait toujours pied7.
(Mer dans laquelle on pouvait sans souci pécher coques et tellines.)
Je suis botaniste : des jours durant je marche sur le sol pour nommer des êtres végétaux. Je suis phytosociologue : j’ajoute à cette liste une composante écologique, je la rends fonctionnelle : les plantes ne poussent pas au hasard, mais celles qui partagent les mêmes exigences écologiques peuvent se retrouver (régulièrement, c’est-à-dire de manière discontinue dans l’espace, formant par là de nouvelles unités supérieures, intégrées) ensemble.
Avec le climat, la ressource en eau, l’exposition et donc la pente, la nature et la structure du sol sont prépondérantes (ressource en eau et exposition lui sont d’ailleurs directement liées).
Le sol est le support du territoire : c’est une banalité que de le dire, mais cela signifie :
1. Qu’on ne peut imaginer un être humain évoluant autrement que sur le sol. C’est-à-dire que le sentiment d’être hors-sol (et je ne parle pas ici du sentiment d’être loin d’un sol, par exemple chez le migrant. Derrida parle à juste propos de nostalgérie par exemple) n’est pas possible sans graves conséquences : notre société semble le montrer à chaque instant.
2. Qu’on ne peut imaginer un être humain qui ne fasse pas lui-même interface entre son être profond (c’est-à-dire sa culture, sa langue, etc.) et son milieu, tout comme la plante se structure dans l’espace là où elle croît. On retrouve ici la notion de médiance d’Augustin Berque qui, dans ces discussions souvent malcommodes se révèle d’un solide secours.
Par un égarement hasardeux, en partie dû à l’incroyable crevaison des cieux qui s’est finalement produite entre Forlì et Cesena, je me suis égaré entre quelques zones et me suis retrouvé sur une route, que j’ai suivie malgré tout, absolument désorienté par les ronds-points, les bretelles, les voies rapides (souvenons-nous que je n’avais jamais conduit en ces terres). Je suis arrivé un peu par hasard à proximité de mon but : c’était un petit pont qui survolait la fin des habitations de la fin de la ville, et nous, jadis, nous arrivions toujours par là ; la petite montée (trois, quatre mètres, pas davantage, mais dans ces plaines, c’était un pic) qui masquait tout et puis tout d’un coup, sur la tangente, la mer, la ville, la plage, les rochers, tout le paysage adriatique révélé comme une récompense du long voyage.
C’était la route. Et le pont arrivait. Mon cœur battait. La pluie avait cessé. L’air était conséquemment très pur, une fois vidé de son humidité. Le soleil se couchait. Le paysage se donnait (à nouveau) alors ainsi : entier. Il se donnait tout à moi.

J’y étais.
Nous entretenons aujourd’hui une épineuse équivoque à l’égard du sol, du territoire et donc du pays. Tout ce qui ramène à la terre d’une part, et à une espèce d’identité est suspect.
Mais dans le même temps, le désir d’un retour à la terre, de campagne, de tradition (musique et danse folk, artisanats, agriculture biologique, et jusqu’aux noms très “troisième république” revenus en force dans les états civils) est toujours plus prégnant.
Or notre monde, dans son cadre politique totalement assimilé au capitalisme, ne voudrait glorifier que l’individu et, corollaire évident, l’identité d’une part, la communauté d’autre part.
Le détour par l’écologie et la géographie nous enseigne pourtant : 1. que l’individu n’existe pas ; 2. que l’identité/la communauté sont des entraves à l’expression d’un projet politique digne de ce nom.
Je gare la voiture juste devant la dernière pension où nous allions, les dernières années. Je fais une grande marche dans la rue, comme nous le faisions jadis.
La ville a-t-elle changé ? Et moi ? Quelle sera la place de la nostalgie ? Et celle de la mélancolie ?
Comme il arrive souvent quand on revient sur un lieu d’enfance, les bâtiments semblent plus petits, comme ratatinés (eu égard à leur “gonflage” dans le souvenir ému), mais ce n’est pas cela qui me frappe en premier. Ce qui me frappe en premier c’est l’aération propre au quartier — il faut dire qu’à cette période la saison balnéaire est un souvenir. L’écartement entre les édifices, l’espace qui est généreux. La rue Porto Palos a changé, il y a une piste cyclable, des aménagements ont été faits ça et là, mais dans l’ensemble c’est la même ville. La plage n’est pas moins différente. La vieille villa dont on rêvait est toujours là ; le petit lunaparc pour enfants aussi. Et le sable.
Comme la pluie est récente, toutes les banquettes de toile sont restées en place. Dans une espèce de friche très rase qui s’est développée à la faveur d’un élargissement de la chaussée, j’observe les escargots encore, rendus actifs par la météo. Ils sont très nombreux, et je dénombre facilement cinq espèces, ce qui en ces lieux, et compte-tenu de l’uniformité du milieu (la plage de sable fin), est plutôt inattendu.
Un escargot est l’inattendu.
Je reste aussi longtemps à la petite marina à regarder la mer tranquille.

Au matin je vais déguster un fameux bombolone dont ces gens ont le secret — lui était resté fiché là comme une madeleine. Et un cappuccino. Le soleil se lève, dissipe les brumes, rosit l’horizon. Au loin on distingue les plates-formes d’extraction de gaz naturel (le trivelle) qui ont fait l’objet d’un récent referendum.
Je le constate comme le soleil devient plus fort : en vérité, il n’y a pas de place possible pour la mélancolie, ni pour la nostalgie. Je n’ai pas été arraché à cette terre, c’est moi qui me la suis appropriée. En saisissant cette saisie, en comprenant cette préhension, et surtout, comme je me suis habitué à le faire depuis que, précisément, j’ai renoncé à comprendre et saisir, en relâchant la bride de l’enfant capricieux, j’ai laissé cette terre, comme ma terre natale, en paix : j’ai cessé de la considérer comme ma propriété, ma possession.
En m’approchant d’un terre-plein où je découvre une plante que j’ai toujours vue et jamais connue : Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald. Je l’avais complètement occultée, elle aussi, qui pousse entre un silène enflé et une sauge à feuilles de verveine. Me revient alors une phrase de Pascal Quignard, qui a écrit deux petits livres sur la terre et le sol8.
Il n’y a pas de terre. Elle est ce qui manque. Elle consiste en ce qui manque quand il se jette sur elle et se roule contre elle.
L’écologue s’est exprimé ; le géographe surenchérit : le territoire est bien la combinaison d’un espace investi (habité) selon différentes dimensions : 1. biogéographique ; 2. personnelle-affective ; 3. sociale et politique ; 4. symbolique.
Condition non négligeable (en ces temps d’ouverture de tous les marchés et, présumément, de toutes les consciences), l’existence de frontières qui autorisent précisément la circulation.
Le sol est indispensable à cette stratification. Il en est la dimension centrale9.
Je n’ai pas été bouleversé du retour à la terre. J’ai épongé ma dette, s’il y en avait une. J’ai vu de nouveaux lieux dans le lieu, ouvert de nouvelles dimensions. J’avais aimé ce voyage.
Je pouvais désormais aller voir ailleurs.

- Agricoles, dirais-je.
- « Les constructions territoriales sont avant tout du temps consolidé », Marcel Roncayolo, La ville et ses territoires, 1990.
- Sans aucune preuve de ce que j’avance, et sans témoignage des échantillons que j’aurais pu apporter à la connaissance (à défaut de porter la connaissance à l’objet), je crois que j’étais en face de Retinella olivetorum (Gmelin), d’une famille, effectivement, à la coquille très fragile (Oxychilideae).
- La Romagne est un territoire historique formant avec l’Emilie la région Emilie-Romagne. La Romagne se constitue des provinces de Ravenne, Forlì-Cesena et Rimini, de la république de Saint-Marin et de quelques communes de Toscane et des Marches.
- À laquelle j’étais revenu, puis que j’avais quittée à nouveau, durablement.
- Spectres de Marx, Eperons, et même dans Marges.
- La mer, destinée à la balnéation, est “canalisée” par une série de digues de grands rochers posées en chevrons sur toute la longueur de ce littoral, qui s’étend quasiment de Venise à Ancône. Le cycle du sable est ainsi conditionné et jusqu’à ces rochers, disposés à une centaine de mètres, il s’accumule en vaguelettes peu profondes.
- Pascal Quignard, Les mots de la terre, de la peur, et du sol, 1978 et Sur le défaut de terre, 1979, d’où est extraite la citation (tous deux chez Clivages, republiés dans Ecrits de l’éphémère en 2005).
- L’existence de frontières, par ailleurs, autorise l’existence du droit du sol. Et autorise l’existence d’une communauté qui ne soit pas fondée sur l’identité (de sexe, de langue, de religion, de culture, que sais-je), mais sur un projet politique. Et, même si aujourd’hui on ne le peut l’affirmer sans être suspect au mieux de réaction, autorise le concept révolutionnaire de nation.

