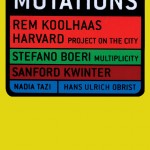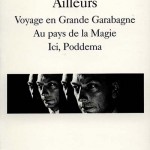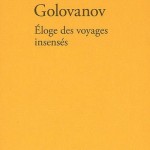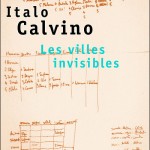En son temps, Michel Butor avait proposé la création d’une “science” nouvelle, l’itérologie, ou science des déplacements humains, des voyages, des exils, des nomadismes.

En tant qu’ils sont objets de l’imaginaire et du langage, je soupçonne les “livres” de littérature (peu importe le genre) de participer, par la téléportation qu’ils provoquent et le déplacement de l’ordre des choses, à l’itérologie (comme corpus, comme agent).
Il n’y a pas que la topologie : qui s’exprime dans les livres sous forme de traité de géographie, de géologie, d’urbanisme ou de tactique militaire (Sun-Zu) ; il y a l’itérologie, ou le nomadisme, quel qu’en soit la cause, et qui est l’expression, littéralement, de la déterritorialisation : on déplace les choses, on chamboule l’espace, on agence, on occupe, on habite.
Voici un premier corpus de textes à ce titre exemplaires. Ces livres sont exorbitants : ils jaillissent du livre (du format-livre) même. Ces livres sont pluriels. Ils traitent de déplacements et d’espace ; ils mélangent les dimensions, les trajets, ils les cartographient. Ils traversent, passagent, dérivent, diffèrent.
Nous cherchons, nous chercherons en quoi ces livres peuvent se retrouver ensemble dans une même main.
— Italo Calvino • Les villes invisibles
— Vassili Golovanov • Eloge des voyages insensés
— Iain Sainclair • London orbital
— Henri Michaux • Ailleurs
— Rem Khoolaas • Mutations
— Arno Bertina, Bastien Gallet, Ludovic Michaux et — Yann de Roeck • Anastylose
— Georges Pérec • Espèce d’espaces
— François Bon • Une traversée de Buffalo
— et peut-être Michel Butor lui-même : Mobile, par exemple.
Lire, écrire, lir&crire, c’est une expérience de l’espace, c’est une expérience de la déterritorialisation. Toute littérature devrait être ceci, pour la bonne raison de la faille, de la rupture de pente, entre la langue/le langage qui est l’universel, et l’expérience singulière de l’auteur-scripteur et du lecteur.
Lir&crire c’est manger les mots de l’autre, c’est parler dans la bouche de l’autre, c’est se déposséder. Ou être possédé. C’est précisément le fantôme-le spectre qui fait surface, c’est l’indit qui se dit, l’inédit qui se fait entendre. C’est la voix impersonnelle.
C’est Personne, le nom joué, le nom passé, le nom échangé ; l’espace : c’est le support, le plan, le vecteur, la scène. La littérature est spatiale parce qu’elle est inquiète. La littérature est inquiète quand elle est espace. Pas d’évidence. Le langage ne dit pas ce qui est. Il est prospectif, prédictif, et même carrément menteur ou délirant. Le langage de la littérature, sur la scène d’espace, n’est pas le langage qui dit les choses comme irl.
C’est le langage qui devient espace (de la lettre/son, à la syllabe, au mot, au chapitre, au livre, et à tout le péri-para-archi-pré-méta-hypo-ad-poly-texte), c’est la littérature en tant qu’elle est un monde propre — avec toponymie, géographie, et sa propre physique (plutôt alchimie peut-être). Il y a des principes de la thermodynamique dans la littérature. Comme des théories du don. Ou des systématiques et des phylogénies.
Justement parce qu’il désigne irl, l’espace littéraire dénonce que quelque chose comme le « réel » puisse exister — ou en tout cas puisse prendre le pas sur les autres life. Ces livres nous le montrent, ne cessent d’y référer.
Dit Claro, à Jean-Clet Martin, à propos de CosmoZ.
Plus qu’une traduction, donc, une série de glissements, de déclinaisons, obéissant à la logique intérieure du livre, lequel traduit pour le coup la fiction en réalité et cette nouvelle réalité en fiction.
Il existe des engins, des mécanismes, des machines à remonter l’espace — ou à démonter l’espace, qui sont un peu des livres, qui sont bien plus, un au-delà du livre, un livre excédé, un livre sorti de ses gonds ; le dehors qui permette de sursoir à tous les irl du monde.
Maintenant, il faut ouvrir ! (Il y aurait bien d’autres textes : Volodine, Chevillard’s Choir, Claro’s Cosmoz sans doute, Borges donc… on y travaille !)