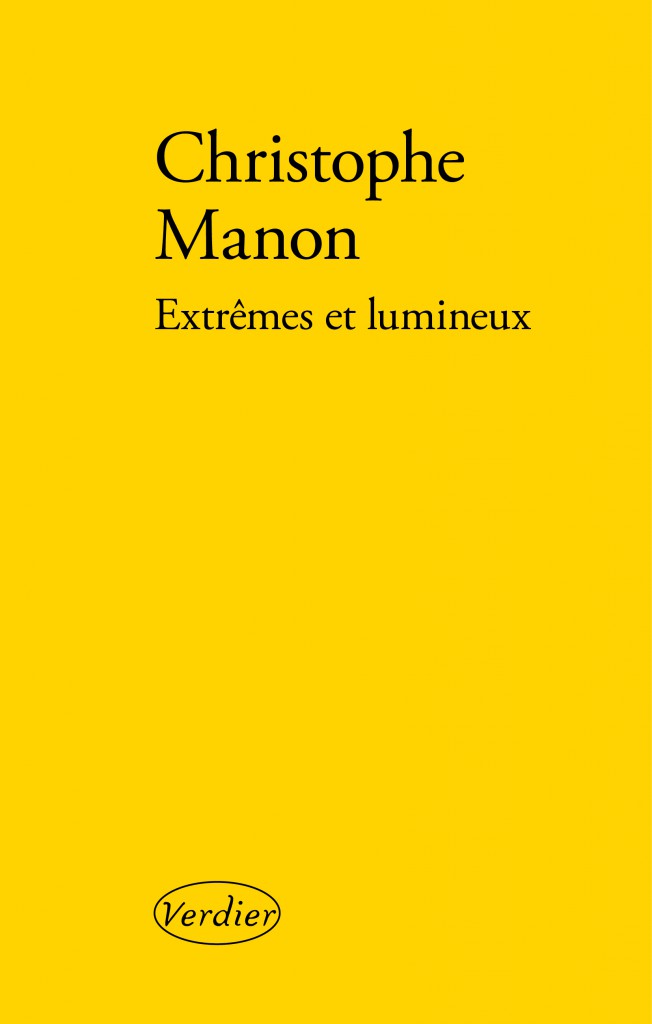

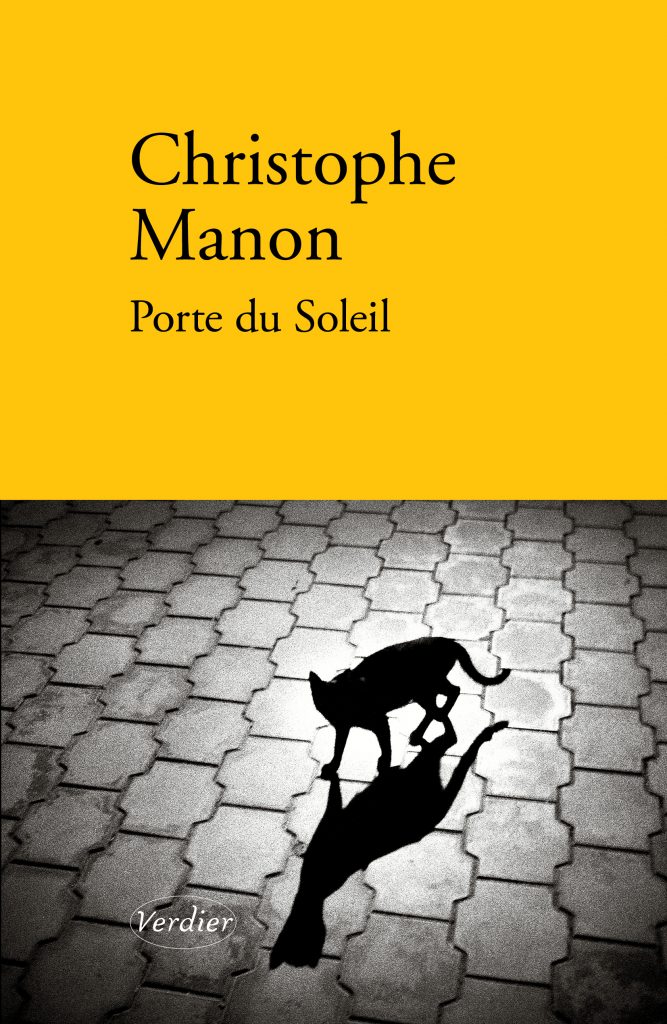
La passion selon Christophe Manon est un livret de famille : Extrêmes et lumineux, cette enquête-rédemption sur les traces de ses aïeux, s’achève avec le troisième volet intitulé Porte du soleil, qui fait donc suite à Extrêmes et lumineux (2015) et Pâture de vent1.
Cette œuvre courageuse, singulière dans le paysage aussi bien poétique que narratif contemporain, mérite que l’on s’y attarde un instant. On s’y attarde un instant, trop bref sans doute pour en saisir toute la moelle (et quelle organique moelle !), mais toujours avec l’intention de décrire (à défaut de comprendre ou d’analyser) cet attrait singulier du poète, subitement, ou pour un projet précis, vers la forme narrative. Ce texte est notre troisième volet à nous, après Brosseau et Taïeb, de Poète cherche récit2.
Sommaire [masquer]
« Toi qu’as », pacte d’écriture
Un cycle se termine donc, pour le poète qui s’est lancé, avec cette suite dans l’aventure d’un texte qui touche lascivement au récit. Entrons directement avec ce que les Italiens appellent le « clou » (en français dans le texte) de cette œuvre expiatoire – le vif du sujet.
Adolescent, j’ai été investi en quelque sorte par mon grand-père de la mission de devenir un écrivain.
Toi qui as de l’instruction […], toi qui as fait des études et qui lis presque autant que moi, tu pourras un jour coucher par écrit tout ce que je te raconte là, tu pourras rapporter mon histoire et celle des tiens, tu publieras des livres dans lesquels nous serons les héros et tu entretiendras notre souvenir comme j’entretiens mon jardin, avec application et respect. (EL)
Voilà ce qu’on lit dans EL, et qu’on retrouve, à peine abrégé, dans PV :
Toi qu’as de l’instruction et qu’as fait des études, t’aurais pu écrire un roman rien qu’en racontant ma vie. (PV)
Cette écriture, ou tout au moins l’écriture de cet ensemble, est une histoire de famille : l’auteur, qui n’est pas ou plus l’auteur du récit, devient le dépositaire de l’histoire, du récit que lui fait son grand-père. J’insiste en premier lieu ici sur ce qui n’est pas un détail : la manière dont le grand-père (par deux fois, notons bien) présente ce qu’on pourrait appeler un dispositif narratif – et que l’auteur nomme la « mission » dont il a été investi — concerne bien l’histoire, plutôt que la mémoire. Ce n’est pas le souvenir, que l’auteur est chargé de reporter ou relater, mais le souvenir recomposé dans un récit, et essentiellement celui-ci, et seulement subséquemment, si l’on veut, selon la classique distinction de Vidal-Naquet ou Carlo Ginzburg.
Un pacte d’écriture est établi (et l’on serait en droit de demander à l’auteur : qui du lecteur de cette histoire de famille ? nous le ferons plus loin), ce qui est une charge tout à fait singulière, je trouve, et une variation très personnelle de la nécessité de l’écriture, dont l’auteur n’est d’ailleurs nullement dupe :
Voici la tâche considérable qui me fut assignée dans mon jeune âge et à laquelle je m’efforce modestement de me tenir, n’ayant au fond pas le choix. Voici pourquoi j’en suis réduit à faire ce que je fais comme une impérieuse nécessité, même si je le fais disons à ma façon. (EL)
Dupe, dans le sens ou il se rédime très particulièrement de cette dette, « à sa façon », c’est-à-dire, sans doute, dans l’écart nécessaire (qui puisse confiner ou s’apparenter à une espèce de parricide) permettant, en retour, l’inscription de la voix singulière, propre, de l’auteur lui-même comme véritable auteur du récit, si récit cela est, que nous allons lire.
Et cette intention se fait jour notamment dans le troisième volume, probablement le moins narratif, de par sa forme, mais aussi sans doute le plus ambitieux et également le plus personnel, le plus « à vide », le plus passionnel (au sens proprement christique su terme ». Manon y découvre en effet, comme par une espèce de rencontre fortuite, le sens de cette immersion.
la forme du livre sur lequel je m’étais engagé
à venir travailler dans ces lieux s’était enfin révélée
PS57
L’histoire des vaincus
Les trois livres, disons-le d’emblée, sont on ne peut plus différents de forme : EL est une espèce de poème en prose composé d’une séquence de textes nombreux de quelques lignes à quelques pages, lesquels textes se terminent tous par un mot coupé en deux, un mot amputé, suivi d’un saut de ligne, et le texte suivant débuté également par un mot amputé, le même qu’à la ligne précédente ou pas, on ne saura pas, jamais, mais chaque partie lisible du mot amputé de sa fin et de celui amputé de son début forment eux-mêmes un mot, de sorte que le texte est en mesure, de la sorte, de se poursuivre indéfiniment, quoiqu’en sautant du coq à l’âne. PV est un diptyque assez contrasté évoqaunt la découverte de leurs corps par deux amants appelés le garçon et la fille, sur fond de brassage, si j’ose dire, de l’histoire familiale du garçon, lequel désigne, sans le feindre, l’amour pour son « petit frère » « mors-né dans le ventre de maman », comme une espèce d’image d’Epinal de la cruauté et de l’horreur du monde, ses désastres et ses masques… Enfin PS représente comme une catabase personnelle, celle du narrateur partie en Ombrie sur les traces de ses aïeux, pour finalement, à travers la tentation et l’échec, subsumer par la langue, et l’aide de viatique picturaux ou littéraires, cette aspiration au paradis, délivré des trop pesants défunts.
Je brosse à grands traits – et le ferai encore, hélas – les parts de ce triptyque beaucoup plus profond et riche que je ne peux le dire. Et leur association, l’association de ces trois livres fort différents, sous le titre d’Extrêmes et lumineux, sous la forme d’une suite à présent conclue, même si elle n’était pas à l’origine du projet, lui donne son élégante cohérence et sa puissante quoique inquiète réussite formelle.
Manon va donc se mettre à rassembler ces éclats de mémoire, de passé, de traces, de souffles évanouis, avec cette nécessité, dit-il d’atteindre « le rêve démesuré, inaccessible et présomptueux de tenter de saisir d’infimes éclats de vie et de ne pas les laisser s’éteindre, soufflant dessus comme sur braises, non pas de dire le monde, car la chose est résolument impossible, mais de le célébrer, non pas de retrouver le temps perdu mais de lui donner son épaisseur, sa mesure en quelque sorte, d’enfin produire une émotion communicable par ses propres moyens » (EL)
Et c’est bien ce qu’il évoque encore dans PV, à la toute fin, désignant, sans le savoir peut-être, l’étrange voyage qui l’attend en Italie, à la recherche des « ancêtres radoteurs et têtus, les vieux édentés et chenus, ont eux aussi rejoint ce terrifiant tumulte depuis la rive lointaine où ils se tenaient accroupis et perplexes, petits tas d’os anonymes recroquevillés sous la poussière des siècles, grelottants et inquiets, égarés dans une solitude éternelle, empêtrés dans leurs vieilles lubies de spectres pathétiques. Toute cette engeance de paysans brutaux, patients, calculateurs, obtus et indécrottables, coriaces, presque analphabètes, avançant avec détermination en donnant la main à cette foutue lignée de ritals, également obtus et brutaux, également coriaces et indécrottables. De taiseux bouseux creuseurs de glaise associés à de bavards bouffeurs de lasagnes et de polenta. »
Les mêmes donc en envoi d’EL, les « anonymes petits tas d’os recroquevillés, figés tête baissée, mains sur le visage, guettant assis dans l’éternité, non pas se matérialisant mais revêtant une sorte de vie fantomatique et irréelle sur quelques vieilles photographies jaunies oubliées au fond d’un tiroir, toute cette lignée de paysannes et paysans pauvres et quasi analphabètes, robustes, opiniâtres, obstinés, mutiques, égarés dans le monde comme au milieu d’une forêt obscure, engloutis dans le flot irrésistible des générations […] des demi-ritals, ni Français ni Italiens, autant dire des moins-que-rien, sans même un sentiment quelconque de leurs propres origines, ne faisant pas même l’effort de les imaginer ou de les retrouver, s’en foutant purement et simplement, juste des bouffeurs de lasagnes satisfaits de leur ignorance, parlant une langue appauvrie et bâtarde, braillards et chaleureux, innombrables… »
Les mêmes mots encore dans PS :
Au fond, nous n’étions que des ritals,
comme dit la chanson, juste de bavards
bouffeurs de lasagnes et de polenta
dotés d’un penchant prononcé à la fois
pour le grotesque et pour la tragédie.
PS28
C’est donc une espèce de pacte d’écriture que l’auteur noue avec le grand-père et, à travers lui, avec ses aïeux. Il y a donc bien un rapport à l’histoire quelque part, le rapport à l’histoire est donc bel et bien en jeu. Mais ici, pour détourner Brasillach, l’histoire, en quelque sorte, est écrite par les vaincus.
Et livre-nous du mal
Mais ce parcours, comment l’effectuer : dans un entretien, Manon dit bien que sa méthode n’est pas scientifique. C’est la littérature qui va l’accompagner dans ce voyage, jusqu’au troisième volume, où justement on retrouve la main donnée de Virgile à Dante, dans ce chemin tortueux et dangereux : « Je partais pour les enfers, j’emportais tout le mal / que j’avais commis contre moi, contre moi et contre les autres. » (PS17, l’auteur souligne).
Or ce parcours doit tout d’abord faire le comptes avec la réalité, cette réalité généalogique, puisque la retrouver pourrait signifier se retrouver, en effet. Malheureusement ici s’élèvent deux obstacles : l’un est le vide comme entretenu par les fantômes, qu’il s’agit de combler ; l’autre est l’adversité même de la famille, jusqu’au plus profond de soi.
Une solution, que l’enfant découvre assez vite, est d’échapper aux tenailles voraces du réel.
Je mentais effrontément et très naturellement. J’étais devenu un menteur patenté, un athlète du boniment, un artiste de la manipulation, un virtuose de l’imposture, un jongleur d’apparences. Je jouais la comédie admirablement. Tel un acteur, je pouvais avec aisance et sans vergogne masquer mes émotions et interpréter un tas de rôles différents. Tel un homme politique, je pouvais avancer sans ciller les plus grossières contre-vérités et je me sortais des situations les plus inextricables, des mauvais pas dans lesquels je m’étais empêtré, avec une habileté qui me réjouissait et satisfaisait mon ego, j’en éprouvais même un dérisoire sentiment de fierté. Je transformais mes échecs les plus pitoyables en triomphes et mes pathétiques lâchetés en glorieuses aventures, je créais des contes, de véritables œuvres d’art, des poèmes dramatiques dont j’étais le héros : je devenais grand, fort, courageux, je me métamorphosais en authentique champion, en gagnant breveté, et j’avançais en funambule accompli sans jamais trébucher. (PV)
C’est sous le signe du mensonge, dans la clef de la duplicité, que va se mettre en place le « dispositif » d’une effarante et sincère confession.
Mais demandons-nous tout d’abord d’où vient ce mensonge : au lieu du lieu flagrant de la turpitude, n’est-il pas simplement l’héritage d’une généalogie brisée, fragmentée, dérélictée elle-même ? Un long fragment (EL) en fait précisément état, bellement (qu’on me pardonne cette longue citation, que j’ai déjà amputée d’autant) :
-prochant prudemment de son passé tel un archéologue qui fouille et retourne la terre à la recherche de vestiges ou de menus indices, interrogeant dans un ressassement insensé les couches superposées du temps afin de remonter à sa surface d’infimes trésors ou de petites reliques privées qui n’ont de valeur significative que pour celui qui les exhume, découvrant que des pans entiers de l’édifice se sont écroulés, ont été endommagés ou irrémédiablement détruits comme à la suite d’un bombardement ou d’une terrible catastrophe, […] un corpus composé d’une série de moments sans cohérence chronologique, sans lien logique entre eux, comme morcelés et suspendus dans le vide, arbitrairement reconstitués et qu’aucun fait tangible ne permet de confirmer, oscillant dans un espace intermédiaire entre la réalité et la fiction […] s’émerveillant de cette étrange et miraculeuse faculté qui consiste à tout moment et selon notre volonté ou par suite de l’impression fortuite produite sur nous par un objet, un lieu, une odeur, une couleur, un sourire, à rappeler quelque chose d’oublié, à rendre présents à l’esprit une notion, un fait, une idée, un événement, considérant avec admiration cette énigmatique fonction qui permet d’abord l’enregistrement puis la conservation puis la restitution d’expériences, d’images mentales, de circonstances, d’informations, de données, que l’on croyait définitivement perdues, leur processus d’encodage, de stockage et de récupération demeurant totalement mystérieux malgré les progrès scientifiques qui ont permis de délimiter précisément les zones du cerveau où s’élabore le prodige et pour ainsi dire dans quelles conditions chimiques ; mêlant ses propres réminiscences à celles d’autres individus connus de lui ou non, s’appliquant à interpréter, à déchiffrer des signes émis par un objet, un être, une photographie, s’efforçant de les traduire sans pour autant chercher à leur trouver un sens, les considérant comme des opérateurs textuels, des matières permettant de déclencher la mécanique verbale, pleinement conscient de l’ambivalence de ce qui survit et cependant a déjà disparu, ne se préoccupant pas non plus d’expliquer le temps qui passe mais s’évertuant bel et bien à l’éprouver, même s’il s’agit au fond d’un exercice impossible, cette introspection méticuleuse ne révélant au final que ce qui a imprégné la pellicule de la conscience, occultant donc une part essentielle de la réalité […] tant de peines et de chagrins, de joies et de menus bonheurs, tant de tourments et de plaisirs devenus des fantômes, des ombres, des silhouettes noires et sans éclat ; errant ainsi dans la brume des résurgences fictives, de l’oubli spécieux ou de l’aléatoire effacement, voire d’une totale dislocation, ne prétendant en aucun cas dire la vérité ni même une vérité, car une vérité, si elle existe, ne se trouve que dans l’accumulation de nécessaires mensonges, le réel étant précisément discontinu, formé d’éléments juxtaposés sans raison dans une infinie complexité de combinaisons possibles et forgés de toutes pièces, d’autant plus difficiles à saisir qu’ils surgissent de façon sans cesse imprévue, hors de propos et aléatoire, s’évertuant donc simplement à tracer des contours illusoires, ambigus et incertains, imaginaires en grande partie, de situations et d’actions sans valeur autobiographique, opérant une plongée fictionnelle dans un temps non pas révolu ni même gaspillé mais proprement consumé, passé à fréquenter les bars, à consommer des drogues, à nouer des amitiés futiles et cependant indéfectibles, à nourrir des amours infructueux et cependant éternels, à frôler les extrêmes dans une lumière trop vive, mais ce travail, cet effort sur soi, presque une conquête, devenant peu à peu une nécessité, consacrant toute son énergie à anal
(EL, je souligne)
Ce mensonge, qui est l’Histoire même, qui est le constituant essentiel de cette histoire, de ces histoires : « J’étais littéralement abreuvé de mensonges à longueur de journées, matins et soirs, soirs et matins, et même à l’heure du déjeuner, et c’était à propos de n’importe quel sujet, même le plus insignifiant, qu’on pouvait ainsi tenter de me tromper et de me mystifier. Et quand je dis on, je parle bien entendu de ma mère. » (PV)
Cette mère qui opère par-là ce tour de passe passe qui donne l’impression au narrateur « de n’être plus [lui]-même », qu’il « enten[d] en somme la voix de [s]a mère parler sous la [s]ienne ».
Ainsi se produit ici un double renversement ; une première dérive se trouve, dès l’origine : la « mission » du narrateur, donnée par un ancêtre, nécessite la plus stricte vérité ; mais ce narrateur est contraint de combler les lacunes, les manquements du réel, par le mensonge, du moins jusqu’à ce qu’il prenne conscience de la nature singulière de la fiction.
Ce premier chagrin, appelons-le ainsi, le conduit à une vie pour le moins dissolue, qui va devenir la deuxième catastrophe à affronter sur ce chemin de rédemption. Et nous suivons alors dans les trois livres les « turpitudes » qui découlent de notre malconformation d’avec le réel.
Venu à Perugia, Ombrie, Italie, en juillet de l’an du Christ 2019,
sur les traces de mes arrière-grands-parents maternels,
à la faveur d’une bourse d’écriture
attribuée par l’Institut français,
en vérité je vous le dis, pendant mon séjour,
j’ai surtout été confronté de façon désastreuse
à la solitude et à l’angoisse face à mes propres turpitudes.
J’avais passé depuis longtemps déjà le mitan de notre âge
et je ne sais pas bien ce que j’espérais trouver
dans ce lointain voyage. J’avais quitté Paris
dans un état d’épuisement et de tension
que je n’avais encore jamais connu auparavant,
après des mois particulièrement difficiles et laborieux.
Je partais pour les enfers, j’emportais tout le mal
que j’avais commis contre moi, contre moi et contre les autres.
PS 17
Faut-il vraiment nous délivrer du mal ? « Le mal n’existe pas et ce n’est pas du mal dont nous sommes victimes, mais de nos turpitudes. PV » Et plus loin : « J’aime savoir qu’il y a du pire parce que le meilleur est toujours possible. »
Et celles-ci ne manquent pas, l’auteur est alors très honnête sur ce point. A sa façon, dit-il, il reprendra le flambeau de l’histoire, et cette façon sera précisément de se mettre soi-même en jeu, un enjeu personnel pour conjurer l’histoire de la communauté.
« Il y a beaucoup de grâce sur cette terre malgré toutes les horreurs qui y sont commises. Je ne suis pas dégoûté des hommes ni du monde comme il va ; au contraire, je trouve leurs imperfections d’une grande beauté et je les en remercie. PV »
Soi-même comme un autre
« J’ai une vie, j’existe, je suis vivant », lit-on finalement dans PS. C’est que ce parcours sans concession, cette radiographie (ou cartographie) des enfers, qui permettent de saisir ce qui semble être la clef de la souffrance, à savoir, apaiser les morts, les fantômes, conduisent le narrateur en Ombrie, donc, sur les terres familiales.
Ainsi croit-on retrouver ici Elisa, sa grand-mère, et son mari Pasquale, probables enfant (lequel des deux, elle sans doute) de ce Filippo Luidi Gaetano Leopoldo Ferranti évoqué dans les deux premiers opus3. Mais le parcours s’emballe : je crois qu’il n’y a pas seulement le choc d’arriver au bout de la quête ; il y a, c’est très nettement indiqué dans le livre, le choc face à la beauté pure, qui vient contrebalancé cette généalogie ratée, et ce trasfert pour le moins chaotique. Sur la terre d’Italie, Christophe Manon se voit comme face à un miroir, un piètre interprète de toute la richesse qui embrasse les primitifs italiens au cœur de ces montagnes d’Ombrie, Assise, Pérouse.
Belles formes multiples. Couleurs vives et brillantes.
PS112, l’auteur souligne
Ainsi la quête se transforme : ce ne sont plus les morts auxquels il s’agit de rendre grâce, mais soi-même qu’il s’agit de sauver, si cela est encore possible.
À courir après des fantômes,
aussi familiers soient-ils,
on n’attrape au mieux que du vent.
J’étais venu avec beaucoup d’amour pourtant,
qui ne me fut d’aucun secours.
[…]
Ce que nous remuons,
ce que nous cherchons obstinément,
ce sur quoi nous enquêtons sans relâche,
ce ne sont que des songes, de frêles apparences
dépourvues de corps et de réalité
qui n’intéressent que les vivants.
Les morts, eux, sont sans histoires,
du moins, je crois,
ne cherchent-ils plus à en avoir.
PS110
Laissons-donc les morts mourir en paix. Réclamons ce qui est dû : la paix, la paix qui est au besoin inquiète, douloureuse ou insoutenable, ou tour à tour riche, heureuse et magnifique.
Seuls les vivants réclament des récits
et les mots dont nous usons
ne sont animés que par notre désir
de vouloir à tout prix réveiller les morts
par leur invocation sonore,
car nous craignons d’être à la fin
comme eux indifférents à l’impénétrable
fouillis des événements.
Entretenir certes le souvenir,
mais il n’y a rien à restaurer,
rien en vérité qui puisse être réparé.
Garder trace, témoigner, mais de quoi ?
Garder trace de quoi : simplement de ce qui de trace ne peut guère en être conscient : « J’ai une vie, j’existe, je suis vivant. »
Je ne comprenais plus qui j’avais été la veille,
j’étais incapable de reconnaître mes traits
lorsque je croisais leur reflet dans une vitrine
ou bien dans le miroir de ma salle de bains.
Tout cela me semblait lointain, étranger.
PS112
La double distorsion méthodique, cet aveu d’aveu, en somme, cette double confession (et comment ne pas penser à l’espèce de déchéance de la confession même, depuis Saint-Augustin, permanent dans ce troisième opus, puis Rousseau et jusqu’à Derrida, venant doubler dans la doublure le texte de sa biographie), qui est en même temps une double catabase, se résoudrait ainsi de manière, allais-je dire, archaïque, sans plus de contact ou de poids donné à l’égo, au je, de sorte que Christophe Manon, aux prises avec la langue avant tout renoue, comme herméneute déjà connu, par exemple de Villon dans l’étonnant et génial Testatment[Léo Scheer, 2011.], inspiré de Villon, et autre catabase d’ailleurs, si catabase est une forme pour désigner la confession, Manon, disais-je, sur les traces du Virgile plutôt que du Dante, maniant avec art et savoir-faire le jeu des miroirs, la fine feuille qui sépare le réel de la fiction comme la vie de la mort, Manon, insistais-je, nous livre ici avec ce triptyque une remarquable mémoire orphique4 faisant de lui, pour notre éternité, le prince de nos poètes.
- Dans la suite du texte Extrêmes et lumineux (2015) sera abrégé EL, Pâture de vent (2019) PV et Porte du soleil (2023) PS. Tous trois ont paru chez Verdier. Ayant travaillé sur les versions epub des deux premiers volumes, je n’ai pas avec moi les numéros de page des livres papier – je les ajouterai.
- Voici le texte sur Brosseau : Mythes diffractés et celui sur Taïeb : Une femme puissante.
- PS 36 : « Elisa Frondizzi a épousé Pasquale Ferranti à Assise ».
- Et je n’y ai pas fait allusion, après coup, me dis-je, tenant de l’inquiétude, la nôtre, celle de la littérature inquiète : « J’éprouvais cette inquiétude malheureuse / des esprits qui coulent et exhibent leur nuit radicale. (PS 61), hardi augustinien, pourquoi cet italique ?

