Texte publié sur Remue.net, « en trois temps », grâce à Guénaël Boutouillet, que je remercie.
Sommaire [masquer]
1. Origine et genèse de FB
Farigoule Bastard est né sur les réseaux sociaux, je vais de suite y revenir, mais dès auparavant une première fois dans le réel.
C’est à l’occasion d’une soirée de l’association La Commère, dans l’extrême sud de la Drôme et les marches de Farigoule-personnage que celui-ci est né. La Commère s’incarne par des personnages, des mannequins grandeur réelle, disposés dans le village (coins de rue, balcons) et relaie les nouvelles du pays. Elle organise également une soirée annuelle, avec différentes animations, balades, stands. On était à la salle des fêtes dudit village, Sahune. Je suis allé fumer une cigarette sur la terrasse, et là fumait également une jeune femme. Devisant avec elle, elle m’apprend qu’elle est bergère1. Je lui dis que je suis botaniste et elle me demande si je connais une plante dont raffolent les bêtes et que les anciens appellent la farigoule bâtarde. Je ne la connaissais pas. Après bien des recherches sur les différents sites et dans les différents ouvrages traitant de taxinomie populaire, je n’ai jamais trouvé de mention de la « farigoule bâtarde ». Farigoule, en patois provençal, c’est le thym. Si le thym est bâtard, c’est qu’on a affaire à une espèce ressemblant au thym. Soit d’un point de vue morphologique (badasse, marjolaine par exemple) soit d’un point de vue biologique (les autres espèces du genre Thymus sont les serpolets, qui sont très nombreux et relativement difficiles à distinguer les uns les autres — et plusieurs sont très courants dans la région).
Le nom, ou binom, au sens linnéen du terme, est resté, et j’ai commencé à le trouver pertinent du point de vue de la fiction, c’est-à-dire qu’il commençait à donner. Farigoule Bastard est ainsi arrivé, comme un binom, au sens patronymique et administratif du terme — Bastard étant un nom de famille répandu un peu partout en France2.
Poussant cette frontière à son bout, j’ai même changé mon nom sur Facebook en Farigoule Bastard, pour écrire quelques statuts inspirés de Haute-Provence : de thym et de moyenne montagne. Certains amis se sont interrogés3.
De là l’idée de développer ce personnage, de nom Bastard, de surnom Farigoule (prénom Jean-Louis), qui passera par son propre canal : une page Facebook par exemple. Dans le même temps, j’entre en contact avec Anthony Poiraudeau et nous convenons d’une série de textes pour Le convoi des glossolales. Farigoule intervient alors, et, pour une durée indéterminée, je cède à Farigoule qui impose son arbitraire à l’ensemble de l’écriture. C’est un peu comme si Farigoule avait été, par mon entremise, en résidence dans le Convoi.
Dans le Convoi on a la possibilité d’être auteur contraint ou non (et donc affranchi). La contrainte d’un paragraphe vaut pour tous, mais l’auteur contraint s’impose une récurrence. Dans ce contexte, Farigoule est intervenu de manière hebdomadaire, le vendredi, parce que, disait-il, « c’est le jour du poisson » (?).
Et c’est ainsi que chaque jeudi soir, je livrais au Convoi le « Farigoule » du vendredi, et ce durant neuf mois entre 2011 et 2012. Et c’est ainsi que le récit s’est construit, pas à pas, dans le flux de l’internet, sur la base d’une rencontre réelle, et par le biais d’une fiction incarnée en langage.
Extrait (Chapitre VIII, page 31)
Les pieds de Farigoule Bastard ne trempent pas, mais s’évertuent, et se campent ou se frottent tout contre le monde qui n’est pas rond, mais complexe polygone de faces et leurs revers, poches toujours répétées, ralentissements détours renversements. À quoi peut bien servir la mesure On ne connaît pas les sous-sols les
niches & alcôves les avens et les plissures il pense. Le monde il est infini Comment veux-tu savoir les chiffres il pense, ahanant. Dans les interstices de ce cairn il y a un monde des fissures des cavités des zones d’air sans contact parce que rien n’est droit ni rigide pareil au froissé du corps pareil à tout ce qui demande un
nom Espacement est séparation. L’espace est possible rencontre & rencontre est juste agencement. Quelques mètres à vol d’oiseau pour ramasser les débris de la Vieille. Mais vol d’oiseau ? Tout ce qui rampe comme Moi et les vers les pourceaux les plus beaux étalons & les cloportes, nous, tous autant, c’est : Un pied devant l’Autre. C’est : (1) par (1). Je ne sais pas même si j’y arriverai, peut-être que cent mètres Presque je renifle un fumet de
marmite éteinte de peu Une maison Une femme Un système Mais qui sait si jamais je pourrai me présenter au seuil toquer gaillardement peut-être appeler sourire faire face. Une poignée d’herbes est tellement loin déjà. Soupire, Farigoule.
2. Domestication du bastard
a. Structure originelle du livre
À l’origine, après le déploiement dans le Convoi, le texte global fut repris sur mon propre site, où il fut alors question d’une première mise en forme de second niveau (au niveau du texte, et plus au niveau du contenu4). Cette nouvelle mouture (qualifiée de geste, alors) était constituée de trois parties (trois cycles) ; il y avait des chapitres numérotés de romain — mais certains de ces chiffres étaient inversés (ou mal écrits, ou incohérents ou erronés : VIX, IVII, IXX par exemple) ; d’autres chapitres, les chapitre cinq, dix, quinze, etc., étaient eux numérotés en chiffres arabes, et constituaient une biasse de correspondances, elle-même double : trois lettres de Farigoule Bastard et d’autres personnages du récit, et trois lettres de voyageurs égarés, de migrants totalement extérieurs au récit ; il y avait des chapitres classés par lettre, de A à E, portraits plus ou moins poétiques de Farigoule Bastard ; il y avait enfin, à la fin de chaque cycle un long poème d’une page dense, de Farigoule Bastard, développé en rhizome depuis une citation d’un auteur existant, sur lequel — à l’époque — je n’avais jamais écrit et le regrettais : Roubaud, Roche, Volodine.
Comme on voit cette structure était plus que complexe et destinée à perdre à l’envi le lecteur. Or le texte étant déjà ardu, il a fallu émonder un peu les frisottis de ce bouillonnement.
b. L’éditeur et l’édition
J’ai envoyé le texte ainsi harnaché à quelques éditeurs choisis (je savais que ce texte n’était pas pour tous), et pratiquement tous m’ont répondu positivement quant à la qualité intrinsèque ; un seul a toutefois bien voulu s’y atteler, Benoît Virot, alors aux éditions Attila, aujourd’hui au nouvel Attila. Le texte fut prêt à être publié en 2013-2014, mais la scission de la maison Attila a contraint à le repousser, ce qui est une bonne chose. Le texte, décanté, a permis qu’on le travaille plus tranquillement, et sereinement. Il n’a pas trop moufté.
Première chose, BV refuse une telle structure : les chapitres poétiques sont évacués (ils ont été publiés par Mathieu Brosseau sur son site Plexus-S) ; les lettres des migrants également (n’ont rien à faire là). On réorganise également l’ordre des chapitres, afin de balancer les chapitres “réels” des chapitres “rêvés”.
Et, chose étrange, on ajoute deux éléments : un chapitre où serait une chanson, le chapitre trente-trois. Deux chapitres sont écrits, dans le va-et-vient et le temps dispersés, dans la confusion des versions, un 33 et un XXXIII, et ils seront finalement mêlés.
L’autre élément, suite à une demande singulière de la part de BV à BV, celle de composer pour l’occasion une chanson. J’ai écrit des chansons, par le passé, dont le ton et la forme sonnaient justement avec ce genre de récit, des histoires de ruisseaux, d’hirondelles (elles ont le ventre blanc) ou de martinets (ils sont noirs faucille), d’amours déçues et d’aulx. Benoît les a entendues. J’ai donc écrit Le couteau, car c’est bel et bien le cœur du récit, sur la base d’un morceau que j’avais abandonné (vous savez qu’on écrit des choses, et puis elles ne tiennent pas dans le temps, trop fragiles, ou vous changez, et elles s’étiolent et meurent, petits ombilics racornis à vue d’œil).
Dans le chapitre trente-trois il est question d’une chanson.
Extrait (Chapitre trente-trois, version inédite, feuillets 84-85)
Elle a fermé les battants des fenêtres. Elle a déposé le voile et défait son chignon. Elle a froissé le tilleul, et jeté des épices dans le petit feu. Elle a infusé le thym avec la sarriette, pétri les pâtes de lierre et écrasé dans le mortier les siliques de vélar mélangées avec les akènes du séséli et du buplèvre.Elle a épuisé l’aristoloche.
Elle a posé à côté d’elle la cuiller d’argent.
Déjà la boucane a envahi la pièce, nourrit les angles. Les lumières sont baveuses, floutées par l’excès de suie. Les formes chancelantes, et les sons étouffés. Elle peut alors lâcher la bride de la raison, à son aise.
Elle tremble, vieille carne, et se raidit d’un coup, puis tremble à nouveau. Ce manège se poursuit encore et à chaque fois plus brusque. On dirait qu’elle rajeunit et, si elle dansait, ce serait de ces danses des terres arides, où des femmes ensorcelées dévident leurs gestes à la manière des bestes, leurs yeux devenus chas.
Les siens sont révulsés, rougies par l’air vicié, sa bouche est soudain pâteuse. Il faut une langue de terre pour dire ce qu’il advient. Lécher serait plus proche que le langage, du reste. Son insomnie prend racine ici, dans un subit dérèglement des lumières. Les cordes se mêlent, et les trames s’épuisent comme neige au sol. La voix se dénoue.
Un son comme au travers d’une porte de chêne, pleine de visserie et large d’une paume, dont la clef est définitivement paumée. Un son rauque et scarieux s’élève du bouquet de caieux, et s’effiloche enfin en hoquets et chuintements. Elle déroule des paysages.
Il y a une ville, une vraie ville, une ville en vrai, en plein, avec des costumes, des odeurs de cuisine, des chaleurs, des misères, des lumières, des objets infinis entassés sur d’infinies limandes.
Il y a une montagne, un grand dévès dénudé, parsemé de boustrigas, de clapas, de failles et d’avens et peut-être une sente tortueuse. Quelques arbres décharnés, déjetés, en quête de soleil ou de terreau plus cléments, miment, arthritiques.
Dans les deux tableaux il est là. Ombre allongée et claudiquante, elle semble chercher chemin. Pourtant non, elle sait très bien où elle va. Elle passe.
3. Envoûtement
a. Possession récurrente
Comme dit précédemment, Farigoule Bastard est né du désir de feuilleton au sein du Convoi des Glossolales. Cette récurrence (hebdomadaire) est le fait, au départ, du bon plaisir de l’auteur, celui de s’adonner au développement pratiquement aléatoire, comme au fil de l’eau, d’un noyau narratif vers son épanouissement. Très sensible à la structure singulière de la revue (aujourd’hui on dirait la série), et nourri en partie à elle, je me suis donc lancé dans l’aventure de poursuivre une histoire à partir de ce simple fait, élémentaire : le nom même de Farigoule Bastard, passé du théâtre réel au masque poétique.
Les premiers textes posent le cadre, et ne semblent pas devoir porter d’autres enjeux littéraires particuliers (autres que celui-ci). Mais dès le début, la langue prend. Une langue singulière, à la fois un peu archaïque, un peu revêche, rocailleuse, me prend.
Pour citer une anecdote qui n’est peut-être pas en ma faveur : je livrais le texte le jeudi pour le vendredi (publié le samedi), chaque semaine. Et, ç’a été le cas plus d’une fois, il m’est arrivé de n’avoir pas du tout préparé la semaine suivante et de devoir écrire en vitesse le prochain “épisode”. Mais au moment de me présenter à la page blanche, la langue venait d’elle même — et avec elle le récit.
Un phénomène rarement éprouvé, me concernant, puisque j’ai cédé pas mal par le passé à des projets d’écriture, comment dire, normés : structurés par une figure (c’est le cas de Local héros qui sort en fin d’année chez Publie.net), épaulés par une configuration particulière (Ge-nove en ce sens en est un peu la démesure), aiguillés par la circonstance (l’écriture quotidienne sur le site, par exemple), ce qui revient finalement à ne faire que du “montage” textuel. C’est une données importante, aujourd’hui, dans la littérature, que de s’emparer d’un sujet du réel et de tourner autour, et dans cette spire trouver un souffle propre. C’est comme si l’on avait peur du récit, de s’adonner totalement à la force intrinsèque du chant5. Au reste, cette puissance narrative, nous l’avons abandonnée à des auteurs qui, pour autant, n’ont pas bougé d’un iota depuis Balzac. On peine aujourd’hui à trouver des auteurs qui ne s’affublent pas d’un dispositif (je ne supporte plus ce mot) d’écriture ou d’un prétexte ponctionné dans le réel, une vie ou une œuvre préexistante.
Je ne dis pas que je n’ai pas fait cela ici, ou que je ne le referai plus jamais, je pose un constat.
Cette peur du récit, sans doute l’ai-je eue moi aussi — on se demande comment on peut écrire la première page d’un texte qui pourrait en compter mille. Mais dans le cas de Farigoule Bastard le personnage était si imposant, son histoire pratiquement insignifiante, et il m’était pourtant tellement familier, que je puis dire que nous avons coécrit ce texte ensemble, qu’enfin je n’ai servi que de support ou de medium pour le laisser venir. En quoi on peut parler peut-être d’une petite mort de l’auteur.
b. Mort de l’auteur
Aujourd’hui le livre est sorti. Comme disait l’autre, maintenant je n’ai plus mon mot à dire. Farigoule Bastard et Farigoule Bastard ne m’appartiennent plus — mais à dire le vrai il ne m’ont jamais beaucoup appartenu.
Je peux l’apprécier pour ce qu’il est, un texte où je trouve de plus en plus de défauts, un chant épique brisé, un réservoir poétique, une ode à mon pays natal, etc. ; mais revenir à son assourcement me semble bien difficile. Chaque jour, chaque lecture, m’éloigne de lui. Je réalise peu à peu son ampleur, je veux dire ce qu’il porte de ces gens, de ces paysages, de ces mots, et cela me convient.
Je le réalise d’autant plus fort qu’il reçoit maintenant des lecteurs, avec leurs impressions, leurs commentaires6.
Je le réalise d’autant plus fort que, malgré vingt ans d’écriture assidue, depuis le texte numéro un et jusqu’au dernier qui est le texte numéro quatre mille trois cent vingt cinq de mon trente-septième carnet, ce livre est mon “vrai” premier livre, mon premier livre papier, en conséquence de quoi j’accède au statut “réel” d’auteur 7.
Accession un peu faussée si l’on considère que nous avons été plusieurs, et même beaucoup, j’en prends conscience en relisant ces trois textes de présentation non dénués d’égocentrisme, à l’écrire.
Écrire devrait toujours nous démettre du propre de la propriété, comme il le fait de l’auteur, de toute autorité.
Extrait (Chapitre XXVI, pages 85-86)
Une voix au fuselage de coton, c’est elle qui venait, heurtoir mou, pointiller sur la coque de Farigoule Bastard, là où derrière se cache du remuant. Il ne parvenait pas pourtant à saisir cette longe trop mince ou trop courte ou trop cassante paille, évaporée entre ses doigts plutôt, dans le miroir les qualités s’étreignent. Confusément on agite autour de lui des corps, un ballet d’épileptiques. Il ne voit pas, puisque dort, ou plutôt dans la profondeur replète de lui-même s’enfonce, comme dans du tissu, comme dans du drap. Il ne voit pas mais devine – la masse d’air ? les tacts électriques ? ce ne peut qu’être simplement du son – il ne devine pas mais flaire, c’est d’un état précis du monde qu’il s’agit, cela demande un inventaire précis, une méthode et un rapport. Il se passe quelque chose. Les outils hélas ne sont pas adaptés, et tous nécessitent une maintenance qui est à cet instant déficiente. Inopérante. Limier erratique, avance au hasard, croit suivre une piste mais ce n’est que le gras de lui-même quand il sombre. Farigoule Bastard s’est effondré en lui.
La voix persiste, lointaine, humide, un filet de voix, une brume, à peine la moue ou l’inspiration. « Monsieur Fayaaaaaaard. » Et se perd, ricoche de limbe en limbe – soit : ne ricoche pas, glisse. « Monsieur Fayaaaaaaard. » S’entend répondre Farigoule Bastard Mon nom est Bastard mais les a-t-il même prononcés. Ces mots. Ne sont-ils pas restés à l’état de chenille de mot, qui tortille sans grâce, cette petite flamme qui résonne dans la coque, dans le creux de l’oeuf, à peine formulés, ou pas, à peine engagés dans l’énonciation ? Qu’est-ce que c’est un mot ? Un morceau de soi qui se décroche et vient toucher dehors. Mais si le soi n’est pas tenu, si le soi est évacué ? Si l’occupant déserte ? Comment, le trafic des mots ? À quelles inclinaisons se rendent-ils ? « Monsieur Fayaaaaaard ? »
- Les bergers sont aujourd’hui eux-mêmes souvent des transhumants, appelés par les éleveurs.
- Et plutôt dans le nord ! J’ai découvert depuis que derrière la tombe du GI, il y a le tombeau de la famille Bastard. N’est-ce pas beau ?
- On m’a même traité de « Claro ».
- J’ai peu d’idées, mais une conception personnelle de la forme littéraire, qui se construit comme un système emboîté, depuis le phonème et le graphème, jusqu’au mot, la phrase, le texte, le livre ou l’œuvre ; chacun de ces niveaux possède son réseau de renvois, d’échos et de tourbillon sémantique, et chacun de ces niveaux peut correspondre avec l’autre ; certains textes ne travaillent que sur un niveau, d’autres les embrassent tous, y compris l’œuvre, impliquant jusqu’à la fiction du nom d’auteur (Blanchot, Pessoa, Tabucchi, Volodine) ; cette conception évacue toute problématique du genre, qui ne me convient pas, ne m’a jamais convenu
- Ou qu’on en n’a pas les moyens. Il est vrai que Farigoule Bastard déménage…
- Les références à Giono sont évidentes ; celles à André de Richaud, Pierre Guyotat ou Rabelais plus surprenantes, mais évidemment elles me ravissent !
- Mais il est vrai que sera passé par là, entretemps, le Général Instin, qui déporte considérablement l’égo littéraire dans ses retranchements textuels
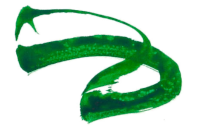

Je viens de terminer l’enregistrement de votre livre pour les mal voyants lecteurs du festival du premier roman de Chambery . Exercice périlleux …. Mais véritable délice, de « mâcher » les mots, leur accumulation, le rythme insensé de l’ouvrage, un vrai bonheur !
Bravo et merci à vous pour cet enchantement !
Marie
Merci à vous, et bravo d’avoir trouvé un espace où répondre dans ce site en pleine refonte !
Merci vraiment de votre message ; en effet ce texte trouve toute sa force, selon moi, à l’oral. Et merci pour le travail que vous faites.